|
» Acquisition
Les conflits de normes de droit écrit
Chargement de vos actualités en cours
 Deux types de conflits peuvent se présenter : d’abord, les conflits entre règles de différentes natures. Ce problème se résout grâce au principe de hiérarchie des normes (Section 1). Il peut également arriver qu’un conflit naisse à l’occasion de la succession dans le temps de plusieurs règles de même nature. Ce type de conflits peut être résolu grâce aux règles d'application de la loi dans le temps (Section 2). Section 1 : Les conflits entre normes de différentes natures : la hiérarchie des normes
Plan de la section[
masquer
]
§1. Description de la hiérarchiePour assurer la cohérence du système juridique, et permettre de régler les conflits entre textes émanant de différentes sources, celles-ci sont hiérarchisées : chaque norme inférieure doit être conforme aux normes supérieures. L’ensemble des règles de droit écrit forme donc une sorte de pyramide. Au sommet : la Constitution, texte fondamental, et les normes assimilées (formant le bloc de constitutionnalité). A la base : une multitude d'actes administratifs individuels. Entre les deux se trouvent les traités internationaux (formant le bloc de conventionnalité) et tous les actes règlementaires ou législatifs, organisés de la façon suivante :
Cette pyramide des normes est parfois appelée pyramide de Kelsen : Hans Kelsen était un juriste austro-américain du début du XXème siècle (Prague 1881- Californie 1973) qui a systématisé un principe de classement des normes. Selon lui, "l’ordre juridique n’est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide ou hiérarchie formée (pour ainsi dire) d’un certain nombre d’étages ou couches de normes juridiques."  Chaque norme est créée conformément aux règles posées par la norme qui lui est directement supérieure, elle-même étant conforme à la norme supérieure, et ainsi de suite jusqu'à la Constitution (qui fait office de norme suprême) cette hiérarchie permet - en théorie du moins - d'assurer la cohérence du système juridique. Elle autorise en tout cas, que des contrôles soient effectués pour vérifier la conformité des normes inférieures aux normes supérieures. La possibilité d'un tel contrôle permet de fonder la légitimité de la norme, qui acquiert sa force obligatoire du seul fait de sa conformité supposée à la norme supérieure. §2. Le respect de la hiérarchie des normesLe contrôle de la hiérarchie des normes peut être accompli à tous les étages, par des organes et selon des règles qui varient en fonction des règles à vérifier, et des normes de référence.
Remarque
1- Il n’existe pas de contrôle systématique : il faut toujours qu’une juridiction soit saisie pour que le contrôle s’effectue. Actuellement, plusieurs normes sont en vigueur qui contredisent des règles supérieures, car elles n'ont pas fait l'objet d'un contrôle spécifique. 2- Deux types de contrôles sont envisageables : un contrôle a priori, qui intervient avant l'entrée en vigueur de la norme ; un contrôle a posteriori, qui permet d'écarter une norme déjà entrée en vigueur. 3- La sanction n’est pas unique : tantôt le texte non conforme sera annulé, tantôt son application sera simplement écartée dans le cas d’espèce. A. Le contrôle de constitutionnalitéLe contrôle de constitutionnalité consiste à vérifier la conformité d'un texte par rapport à la Constitution et aux normes assimilées (bloc de constitutionnalité).
Il est susceptible de concerner aussi bien les traités internationaux que les lois. 1. La conformité des traités internationaux à la ConstitutionLa supériorité de la Constitution sur les traités internationaux a été longuement discutée, avant d'être affirmée en 1998 par le Conseil d'Etat (arrêt Sarran et Levacher, CE 30 octobre 1998, D. 2000 p. 152, note Aubin) et en 2000 par la Cour de cassation (arrêt Fraisse, Ass. plén. 2 juillet 2000, D. 2000, p. 865, note B. Mathieu et M. Verpeaux). L'organe compétent pour exercer ce contrôle est le Conseil constitutionnel. On a vu que, en vertu de l'article 54 de la Constitution, si le Conseil constitutionnel estime qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier le traité ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Exemple
Ainsi, la loi constitutionnelle du 4 février 2008 a modifié le titre XV de la Constitution, pour permettre la ratification du Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 2. La conformité des lois à la ConstitutionDeux types de contrôles peuvent être opérés : le premier, mis en place avec la Vème République, intervient a priori ; le second, issu d'une loi constitutionnelle de 2008, intervient a posteriori
Ces limites ont fait l'objet de nombreuses critiques, qui ont conduit à l'adoption de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi, il est désormais possible pour tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi, même plusieurs années après sa promulgation. Si le Conseil constitutionnel estime que la loi n'est pas conforme, alors celle-ci sera abrogée. La Question prioritaire de constitutionnalité ouvre aux citoyens la possibilité historique de participer au contrôle de conformité des lois à la Constitution. Elle permet d'obtenir l'abrogation de textes qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Elle augmente encore le rôle du Conseil constitutionnel, qui se voit institué comme le gardien permanent de la hiérarchie des normes.
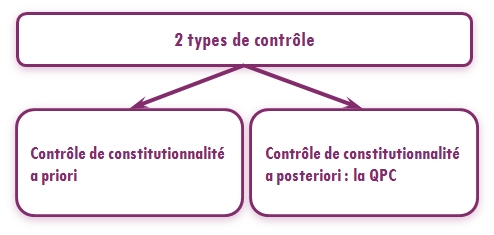 B. Le contrôle de conventionnalitéLe contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la conformité des lois aux conventions et traités internationaux.
Si l'on a rarement dénié le principe d'une supériorité des traités sur les lois internes, la question s'est posée de savoir quel organe ou juridiction était en pratique compétent pour effectuer le contrôle de conventionnalité d'une loi, et éventuellement écarter la loi contraire à un traité international. La question est particulièrement cruciale dans le cas où la loi est postérieure à la norme internationale en question : en effet, dans la situation inverse, on admet assez facilement que la norme supérieure a automatiquement abrogé la loi antérieure qui lui était contraire : lex posterior priori derogat. Le conflit se règle alors sans difficulté. En 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence sur ce point (à l'occasion de l'examen de la loi sur l'.I.V.G. du 15 janvier 1975). Restait à connaitre la position des ordres judiciaire et administratif à ce sujet.
Cette question a donné lieu à une fameuse divergence entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation :
Remarque
Le juge ordinaire ne peut pas abroger la loi contraire aux engagements internationaux de la France. Il ne peut qu'écarter cette loi du litige qui lui est soumis. Les décisions Jacques Vabre et Nicolo ont marqué la fin de la suprématie inconditionnelle du droit interne, et ouvert en faveur du droit international une brèche considérable dans le droit positif. Elles ont ainsi permis l'introduction pleine et entière du droit communautaire et de la Convention européenne des droits de l'homme en droit français.
Des principes fondamentaux comme le droit à un procès équitable porté par l'art. 6 Conv. EDH, ont ainsi pu modifier profondément la procédure devant les tribunaux nationaux des deux ordres. C. Le contrôle de légalitéLe contrôle de légalité consiste à apprécier la conformité des règlements par rapport aux lois.
Ce contrôle est en principe dévolu aux juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation pour excès de pouvoir (qui conduit à l'annulation de l'acte illégal), ou d'une exception d'illégalité (qui tend à faire écarter, à l'occasion d'un litige particulier, l'application d'un acte illégal). Une exception est un moyen de défense soulevé à l'occasion d'un procès. L'exception d'illégalité est un moyen de défense par lequel un justiciable invoque la non-conformité à la loi d'un règlement qui lui est opposé.
EXCEPTIONS :
Ainsi, les normes de droit écrit sont-elles organisées selon un ordre hiérarchique qui leur impose d'être conformes aux normes qui leurs sont supérieures. Le respect de cet ordre fonde leur légitimité, et est susceptible d'être contrôlé par différents organes, selon des règles variables. C'est à ce prix que sont assurées, autant que faire se peut, l'articulation entre les normes de nature différentes, et la cohérence du droit objectif français.
D'autres règles permettent de régler les conflits survenants entre normes de même nature. |