1. Action de groupe en droit de la consommation : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art.
L. 623-1 et s., C. conso.)
Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées pouvaient agir devant les juridictions civiles (compétence du tribunal judiciaire et possibilité de médiation) afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :
- à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d'un bien immobilier ;
- ou pour des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles (droit interne et européen).
Rq.A l'origine l'art. L 623-1 visait uniquement la vente de biens ou la fourniture de services. Une décision rendue par le TGI de Paris début 2016 avait déclaré recevable une action intentée en matière de baux d'habitation, considérant de manière extensive que le champ de l'action de groupe s'étendait au droit de la consommation et pas seulement au code de la consommation. Cette décision avait aussi fait apparaître l'importance déterminante des cas exposés et la forte médiatisation à laquelle se livrent les associations (TGI de Paris, 27 janv. 2016,
D. 2016 1690, note B. Javaux - V. aussi B. Javaux, « Libre propos autour de l'arrêt de la CA de Versailles du 3 novembre 2016 »,
D. 2017 630). Ce jugement avait été infirmé par la Cour d'appel de Paris, qui avait estimé l'action de groupe inapplicable aux baux d'habitation régis par la L. 6 juillet 1989, ceux-ci étant exclus du champ d'application du droit de la consommation (CA de Paris, 9 nov. 2017,
JCP G 2018 Fasc. 18 n° 530 / §4 obs. E. Jeuland). Cette solution avait été validée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1
ère, 19 juin 2019, n°
18-10.424), mais entre-temps la loi ELAN du 23 novembre 2018 avait clarifié les choses et modifié l'article L. 623-1 du C. conso. pour étendre l'action de groupe à la réparation des préjudices subis par des consommateurs dans le cadre de la location d'un bien immobilier.
L’action de groupe ne pouvait porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Le juge devait constater dans la même décision que les conditions de recevabilité étaient réunies et statuer sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés par l’association. Il définissait le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel était engagée et fixait les critères de rattachement à celui-ci. Il déterminait les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chaque catégorie de consommateurs constituant le groupe, ainsi que leur montant ou les éléments permettant l’évaluation des préjudices. Si cela paraissait adapté il pouvait fixer les conditions d’une réparation en nature.
Si la responsabilité du professionnel était retenue et n’était plus susceptible de recours, le juge ordonnait des mesures de publicité, à charge du professionnel, pour aviser les consommateurs concernés. Ceux-ci disposaient d’un délai (entre 2 et 6 mois) pour se faire connaître auprès de l’association et obtenir la réparation de leur préjudice. Etait réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
S’agissant de l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence, la responsabilité du professionnel ne pouvait être prononcée que sur le fondement d’une décision rendue à son encontre par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne, constatant ses manquements et n’étant plus susceptible de recours sur ce point. Dans ce cas, les manquements du professionnel étaient réputés établis de manière irréfragable pour la mise en œuvre de l’action de groupe, qui devait être engagée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle la décision n’était plus susceptible de recours.
Il existait une procédure d’action simplifiée : lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés étaient connus et qu’ils avaient subi un préjudice d’un même montant ou identique, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, pouvait condamner celui-ci à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixait.
Les décisions rendues avaient autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice avait été réparé au terme de la procédure.
L’adhésion au groupe ne faisait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge.
La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 2014, avec la publication du
décret n° 2014-1081 du 24 sept. 2014 (art.
R. 623-1 s., C. Conso.).
Au plan territorial, était compétent le tribunal judiciaire du lieu où demeurait le professionnel défendeur, ou le tribunal judiciaire de Paris s'il demeurait à l'étranger ou n'avait ni domicile ni résidence connus.
D'un point de vue procédural, le texte opèrait un renvoi au CPC en l'absence de disposition spéciale, prévoyait la mise en oeuvre de la procédure ordinaire en première instance et de renvoi à l'audience de l'art. 905 du CPC en appel. Il précisait les modalités d'information des consommateurs et les conséquences de leur adhésion au groupe (mandat avec la ou les associations s'il y en a plusieurs).
Tx.Jurisprudence :
Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles a donné à penser que l'association à l'origine de l'action de groupe ne pourrait renoncer unilatéralement à son droit à agir, l'action ne visant pas à faire reconnaître un droit propre mais étant exercée à seule fin d'obtenir réparation de préjudices économiques subis par des consommateurs formant un groupe identifié (Versailles, 14 nov. 2023, n°
22/07502, Gaz. Pal. 23 janvier 2023 obs. M. Brueder p. 54).
2. Les actions de groupe relevant de la loi J21
Comme indiqué auparavant, la loi conservait un champ d'application déterminé, limité à cinq secteurs :
- lutte contre les discriminations ;
- art. L. 1134-6 à L. 1134-10 du Code du travail ;
- art. L. 142-3-1 du Code de l'environnement ;
- droit de la santé (chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du CSP) ;
- art. 43 ter de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978.
La loi du 18 novembre 2016 contenait des dispositions générales communes, intéressant pour certaines le juge judiciaire, pour d'autres le juge administratif. Elle comportait également des dispositions spéciales propres à chaque secteur. Elle a été complétée par un décret n° 2017-888 du 6 mai 2017.
Seules les grandes lignes des dispositions communes de la loi J21 seront évoquées ici.
Dans tous les cas, l'action de groupe visait à la réparation des dommages causés par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de celle-ci à ses obligations légales ou contractuelles.
Limitée quant aux actions visées, la «
class action » française était également encadrée quant aux titulaires du droit d'agir. Comme en droit de la consommation, l'action de groupe n'était ouverte qu'aux associations et seules certaines d'entre elles ont été habilitées à agir :
- en matière de santé, les associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'art. L. 1114-1 du CSP;
- dans les autres domaines, les associations agréées et les associations déclarées depuis 5 ans au moins dont l'objet statutaire comportait la défense des intérêts visés.
Les actions étaient, cette fois encore, finalisées quant à leur objet et leur cause :
- l'action de groupe santé, visait à la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique ayant pour cause commune le manquement d'une même personne à ses obligations. L'action ne pouvait tendre qu'à la réparation des préjudices résultant des seuls dommages corporels, non de dommages patrimoniaux ;
- les autres actions pouvaient, selon le cas, tendre à la cessation du manquement ou à l'engagement de la responsabilité de l'auteur du dommage afin d'obtenir réparation des préjudices subis, voire à ces deux fins. La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, relative à la protection des données personnelles, a autorisé l'action de groupe aux fins de réparation.
S'agissant de la mise en œuvre de l'action de groupe, la procédure comportait déjà plusieurs phases et un système d'opt in pour être associé à l'action.
Tout d'abord, sauf en matière d'action de groupe santé, était imposée une mise en demeure préalable, à l'auteur du manquement, de le cesser ou le faire cesser ou de réparer les préjudices subis. L'action ne pouvait être introduite que 4 mois après réception de cette mise en demeure. La fin de non-recevoir tirée du non-respect de cette exigence pouvait être soulevée d'office.
Si l'action était jugée recevable, la première phase aboutissait à un jugement statuant sur :
- la responsabilité du défendeur, au vu des cas individuels présentés par l'association ;
- la définition du groupe d'usagers et les critères de rattachement à celui-ci ;
- la détermination des préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque catégorie du groupe (dommages corporels pour l'action de groupe santé) ;
- le délai d'opt in (en matière de santé, ce délai devant être compris entre six mois et cinq ans, et commençait à courir au terme des mesures de publicité).
Tx.Action de groupe santé : Cass. Civ. 2
ème, 2 mai 2024 n°
22-10.480, DA 22 mai 2024 note M. Barba, Proc. 2024 Fasc. 7 n° 162 note S. Amrani-Mekki : lorsqu'un juge de la mise en état est désigné dans la première phase de l'action de groupe pour ordonner une mesure instruction, celle-ci doit être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou du prestataire utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l'action de groupe et aux dommages susceptibles d'être réparés.
La seconde phase concernait aussi la mise en œuvre du jugement, l'indemnisation et le règlement des différends. Elle débutait par des mesures d'information des consommateurs, à la charge du professionnel, devant être adaptées à la situation.
L'usager devait ensuite adhérer au groupe. En principe, il pouvait adresser sa demande de réparation soit directement au responsable, soit à l'association demanderesse à l'action, qui receait ainsi mandat aux fins d'indemnisation.
Si en matière de santé, la procédure de réparation des préjudices ne pouvait être qu'individuelle, dans les autres secteurs, la loi prévoyait une possibilité d'une procédure collective négociée de liquidation des préjudices. Cette procédure s'intègrait dans la recherche de solutions amiables, encouragée par la loi, qui incitait également au recours à la médiation.
Les décisions rendues ont eu autorité de chose jugée à l'égard des personnes dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. L'adhésion au groupe ne faisait toutefois pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation de préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement ou par un accord homologué dans le cadre de la procédure. Etait en revanche irrecevable toute autre action de groupe fondée sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices.
Bibliographie indicative :
- Action de groupe en droit de la consommation :
- Commentaires des textes :
- V. Rebeyrol, « La nouvelle action de groupe », D. 2014 940.
- N. Molfessis, « L'exorbitance de l'action de groupe à la française », D. 2014 947.
- K. Haeri et B. Javaux, JCP G 2014 Fasc. 13 n° 375, «L'action de groupe à la française, une curiosité ».
- M. Bacache, JCP G 2014 Fasc. 13 n° 377, « Introduction de l'action de groupe en droit français ».
- E. Jeuland, JCP G 2014 Fasc. 14 n° 436 : l'auteur considère qu'il s'agit d'une action en substitution devenant ensuite une action en représentation.
- F. Brunet, A. Dupuis et E. Paroche, « L'action de groupe : l'indemnisation des consommateurs favorisée au détriment de la détection des cartels », D. 2014 1600.
- M. Bacache, « Action de groupe et responsabilité civile », RTD civ. 2014 450.
- M. Albertini, « Les points-clés de l'action de groupe pour les entreprises », JCP G 2014 fasc. 46 n° 1196.
- S. Amrani Mekki, « Décret sur l'action de groupe – La procédure... enfin ! », JCP G 2014 Fasc. 42 n° 1030.
- S. Amrani Mekki, « L'action de groupe, mode d'emploi », Proc. 2014 Fasc. 12 n° 16.
- H. Croze, « Action de groupe de droit commun ; schéma procédural », Proc. 2014 Fasc. 12 n° 17.
- Premier bilan d'application et perspectives : MJ Azar-Baud et S. Carval, « L'action de groupe et la réparation des dommages de consommation : bilan d'étape et préconisations », D. 2015 2136.
- K. Haeri et B. Javaux, « Le bilan des actions de groupe 4 ans après », JCP G 2018 Fasc. 47 n° 1236 : 16 actions dont 12 en consommation. deux transactions
- Action de groupe santé :
- M. Bacache, « Les spécificités de l'action de groupe en droit de la santé », D. 2016 64.
- K. Haeri et B. Javaux, « L'action de groupe en matière de produits de santé : une procédure complexe à l'efficience incertaine », D. 2016 330 - JCP G 2016 Fasc. 14 n° 414 I 1 obs. E. Jeuland.
- S.Amrani-Mekki, « Action de groupe santé. - Un nouveau modèle pour de nouveaux préjudices », JCP G 2016 Fasc. 6 n° 146.
- A.Laude, « L'action de groupe en santé, à l'épreuve de sa complexification », D. 2017 412.
- Loi J21 :
- S. Amrani-Mekki, « Le socle commun procédural de l'action de groupe (...) », JCP G 2016 Fasc. 50 n° 1340.
-
Chronique Droit judiciaire privé, JCP G 2016 Fasc. 48 § 1.1.
- N. Chifflot,
- « Les principaux apports de la loi (J21) en contentieux administratif », JCP G 2016 Fasc. 51 n° 1377 ;
- « Accès collectif au juge administratif : l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droits », Proc. 2017 Fasc. 2 étude 5 ;
- « Accès collectif au juge administratif : l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droits », Proc. 2017, Fasc. 2 étude 5 ;
- « Règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance des droits devant le juge administratif », Proc. 2017 Fasc. 7 n° 28 (décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits).
- E. Jeuland, « Retour sur la qualification de l'action de groupe à la lumière de la loi J21 », JCP G 2017 Fasc. 13 n° 354 (L'auteur considère qu'il y a privatisation et externalisation de la justice. L'action de groupe a la nature d'une action de substitution puis d'une action en représentation dans les droits de réparation).
- H. Croze, « Un droit commun de l'action de groupe ? », Proc. 2017 Fasc. 2, étude 4.
- A. Bugada, « Justice du XXIe siècle : l'action de groupe en matière de discrimination dans les relations de travail », Proc. 2017 Fasc. 2, étude 6.
- S. Deygas, « L'action de groupe devant le juge administratif : mode d'emploi », Proc. 2017 Fasc. 7 n° 27.
- C. Boillot, « Action de groupe et règlement amiable - A propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017 Fasc. 6 n° 155.
- V. aussi : M. Ranouil, « Action de groupe, assurance et fonds d'indemnisation », JCP G 2017 Fasc. 26 n° 747.
- « Action de groupe – Une promesse séduisante, une application décevante », JCP G 2018 Fasc. 19 n° 558 – entretien par P. Metals et E. Valette.
- L. Lopez, « Les parties prenantes en matière de Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) : les oubliés de la loi J21 en matière d'action de groupe. Proposition d'une nouvelle forme d'action », Proc. 2018 Fasc. 2 Etude 3.
- Rapport d'information n° 3085 Mission Assemblée Nationale 11 juin 2020 (Actions de groupe, bilan et perspectives, JCP G 2020 Fasc. 25 n° 760 : 13 propositions ; L. Cadiet, « Action de groupe : cela marchera-t-il mieux ? », Proc. 2020 Fasc. 8-9 repère 8
- M. Brochier, « Class actions à la française : abondance d'actions nuit-elle ? », D. 2020 1578

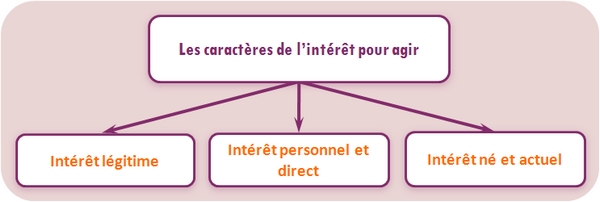
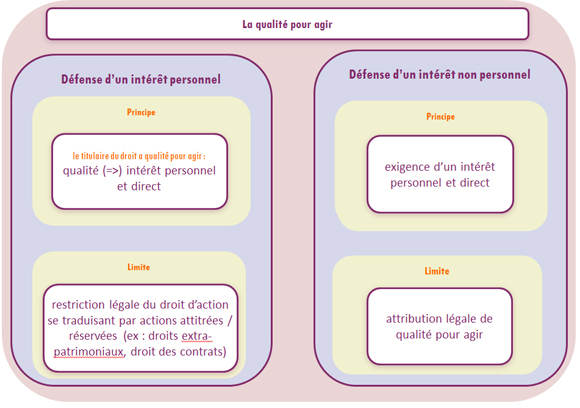
Partager : facebook twitter google + linkedin