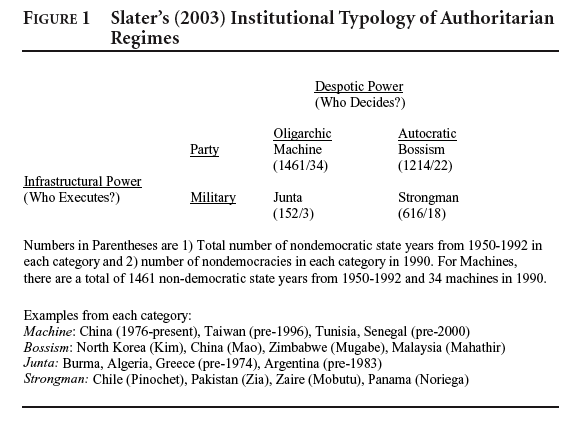Selon le célèbre mot de Paul Valéry : « Si l’État est fort, il nous écrase ; s’il est faible, nous périssons » (in Regards sur le monde actuel). La formule met en valeur un paradoxe. Alors qu’il a pour fonction de réguler la société dans son ensemble, le pouvoir d’État est constamment soumis à un danger ou plutôt à un risque de dérive : celui de générer des déséquilibres, d’introduire du dysfonctionnement. Le plus souvent, l’émergence d’une forme pathologique de pouvoir d’État procède d’une désorganisation de la société. Celle-ci engendre à son tour le règne de la déraison qui peut aller jusqu’à l’instauration d’une entreprise de déshumanisation. Dans la mesure où nous ne traitons pas d’un dysfonctionnement occasionnel mais d’une dérive institutionnalisée, nous rencontrons alors la notion de « régime politique ».
Cette dernière doit être précisée car elle risque d’engendrer des confusions car elle est employée en science politique mais aussi en droit constitutionnel. Or, elle ne vise pas la même chose.
- Le système institutionnel
Df.Le système institutionnel est une notion qui recouvre exclusivement l’organisation officielle des principaux pouvoirs institués ou encore les relations juridiques entre les pouvoirs constitutionnellement établis.
Une autre manière de définir cette notion est de dire qu’elle désigne la forme juridique du gouvernement.
- Le système politique
Df.Ce concept vise l’ensemble unifié des règles du jeu politique c’est-à-dire la totalité des règles régissant l’organisation du pouvoir.
Le système politique va ainsi s’intéresser aux partis politiques, à leur organisation, à leur fonctionnement. Historiquement, cette notion fut utilisée par les théoriciens pour démontrer la permanence du fait élitiste. Ainsi, l’analyse en termes de systèmes conduira certains sociologues à juger que le gouvernement de tous (la démocratie) est, en réalité, traversé par des mécanismes oligarchiques de sélection qui se sont logés dans l’organisation interne des partis politiques.
- Le régime politique
Df.Le régime politique est un concept qui articule d’un côté, le mode d’organisation du pouvoir et d’un autre côté, son mode d’exercice. Il ne s’intéresse donc pas seulement aux règles relatives au pouvoir politique mais aussi aux hommes, à leurs pratiques.
Par exemple, un régime politique sera traditionnellement défini par le nombre de détenteurs du pouvoir (un, quelques-uns et tous) et par la manière dont ce pouvoir est exercé (conformément à des lois ou de manière arbitraire). Le gouvernement d’un seul sera par exemple décliné en monarchie et en tyrannie. Une autre de manière d’exprimer cette idée est de souligner qu’un régime politique désigne la forme politique de gouvernement. Le régime politique s’intéresse donc, par-delà le système institutionnel, à la relation de ce dernier avec le système partisan et avec la société civile (l’opinion publique et ses relais). Par rapport à la notion de système politique, le régime politique implique la prise en compte de la dimension d’exercice du pouvoir et une moindre attention à la dimension d’organisation.
Section 1 : Les régimes totalitaires
Rarement un concept tel que celui de totalitarisme fut aussi controversé. Il est vrai que le mot ne fut pas d’abord un concept mais simplement une notion utilisée dans le discours politique. Devenue un concept, son utilisation fut toujours connotée par des enjeux parasites. En un certain sens, le totalitarisme paie surtout le prix de son ambition : celle de pointer une rupture dans les modes de domination du XXe siècle. Il présuppose le caractère incommensurable, irréductible de la domination totale qui émergea à travers le nazisme et le stalinisme tout en postulant une certaine équivalence des régimes
§1. Le concept de totalitarisme
A – Histoire du mot
- La phase d’émergence
Dans le champ intellectuel : Durant les années 1930, plusieurs intellectuels comme Kautsky et Élie Halévy pressentent la possibilité de dégager une nouvelle forme de « tyrannie moderne » à partir des exemples européens comme la Russie, l’Italie et l’Allemagne. En particulier, ils ont l’intuition que le communisme et le fascisme ont bien des points communs : ils s'ont d'abord le fruit de la guerre de 1914, sont antilibéraux et souvent anti-démocratiques, constituent des passions collectives révolutionnaires, conservent une habitude de la violence, soumettent l'individu au collectif en le régentant totalement ; ils ont également le même développement en deux étapes, l'une constitutive avec Lénine et Mussolini ouvrant la voie à l'autre, la radicalisation avec Staline et Hitler.
- L’appropriation scientifique
La généralisation après Arendt : Après la seconde guerre mondiale, le concept connaît une évolution heurtée largement dépendante de l’image de l’union soviétique chez les intellectuels et du contexte international. Il connaît un regain d’intérêt durant la première phase de la guerre froide et atteint son apogée avec la publication et le succès public du troisième volet des Origines du totalitarisme par Hannah Arendt en 1951. A la suite de ce livre et durant toute la décennie suivante, il devient un concept clé abondamment discuté mais aussi contesté. Des livres comme celui de Jacob Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy (1952), celui de Carl Friedrich et Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956) et le colloque de l’American Academy of Arts and Sciences publié par Friedrich en 1953 et intitulé Totalitarianism, tous témoignent de l’influence grandissante de ce concept. Il sera cependant largement victime de la « détente » si bien que dès les années 1965, il cesse d’occuper l’avant-scène et se raréfie au niveau international.
Rq.Le cas de la France
La situation sera toutefois différente en France. En raison d’une séduction considérable du modèle communiste chez les intellectuels de gauche, la notion de totalitarisme est restée largement bannie. Vers le milieu des années 1970, la situation est très contrastée : au plan international, les critiques de la notion se multiplient particulièrement chez les sociologues et les historiens ; en France, le concept acquiert subitement une légitimité et revient considérablement à la mode sous le coup de la prise de conscience de la nature réelle du système soviétique. Cette prise de conscience est d’abord consécutive à l’émergence des dissidents et en particulier à la publication de L’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne (1974). Elle est prolongée par la vague des nouveaux philosophes qui s’en prennent très directement à l’URSS et à son emprise sur la vie intellectuelle française (André Glucksman, Bernard Henri-Lévy, Alain Finkielkraut). Au total, le concept de totalitarisme s’est imposé partout mais le désaccord quant à son contenu demeure très important.
La situation sera toutefois différente en France. En raison d’une séduction considérable du modèle communiste chez les intellectuels de gauche, la notion de totalitarisme est restée largement bannie. Vers le milieu des années 1970, la situation est très contrastée : au plan international, les critiques de la notion se multiplient particulièrement chez les sociologues et les historiens ; en France, le concept acquiert subitement une légitimité et revient considérablement à la mode sous le coup de la prise de conscience de la nature réelle du système soviétique. Cette prise de conscience est d’abord consécutive à l’émergence des dissidents et en particulier à la publication de L’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne (1974). Elle est prolongée par la vague des nouveaux philosophes qui s’en prennent très directement à l’URSS et à son emprise sur la vie intellectuelle française (André Glucksman, Bernard Henri-Lévy, Alain Finkielkraut). Au total, le concept de totalitarisme s’est imposé partout mais le désaccord quant à son contenu demeure très important.
B – Le débat autour de Hannah Arendt
Il n’est pas possible d’évoquer le concept de totalitarisme sans revenir sur l’apport de Hannah Arendt et sur les conséquences qui en résultèrent.
- L’analyse du totalitarisme par Arendt
Une catégorie nouvelle : L’originalité de son travail est donc d’abord de porter un regard philosophique sur le phénomène inédit de domination totale en tentant de le conceptualiser pour définir une nouvelle catégorie de la pensée politique. Dans les trois premiers chapitres, elles s’attachent à repérer les caractéristiques historiques, sociologiques et institutionnelles communes aux régimes totalitaires. À partir du quatrième chapitre, elle entreprend une réflexion pour définir et délimiter cette nouvelle catégorie.
Les lois de mouvement : Arendt soutient que le caractère inédit de ce régime provient de ce qu’il fait imploser les catégories traditionnelles en particulier l’alternative classique entre régimes sans lois et régimes soumis à des lois. Nazisme et communisme ne sont pas des régimes sans lois mais plutôt des régimes incarnant une loi surhumaine qui prend la forme tantôt d’une loi de l’histoire, tantôt d’une loi de la nature. Le sens même de la notion de loi s’en trouve changé. Par exemple, le despote classique est défini comme celui qui se soustrait aux lois positives mais son pouvoir s’adosse toujours à une référence stable comme la loi divine ou la loi naturelle. Donc même dans le cas du despotisme, la loi constitue un cadre stable permettant de situer l’action. Dans le totalitarisme, au contraire, la loi est une loi de mouvement dont la finalité est la production d’une nouvelle humanité plus pure. La terreur que l’on constate dans ces régimes totalitaires n’est donc pas utilitaire ou fonctionnelle (maintenir la stabilité) ; elle est l’expression de la loi de mouvement et donc l’essence de ce régime. Non seulement cette « légalité » implique de définir un « ennemi objectif » (le bourgeois ou le non-Aryen) mais cette légalité sera constamment changeante si bien que toute action peut devenir un obstacle à la purification et nécessitera donc l’élimination de l’acteur.
- Les caractéristiques de l’analyse d’Arendt
Le rôle de l’idéologie : elle privilégie considérablement le rôle de l’idéologie. Arendt n’est pas totalement fermée aux autres éléments ; par exemple, elle souligne que le totalitarisme s’accompagne de la réduction du corps social et politique à une masse atomisée. En d’autres termes, le totalitarisme naît là où le système social stratifié s’est effondré, là où le lien social, le « mur protecteur de la cohésion », le sentiment de communauté a disparu. De même Arendt souligne le rôle de la propagande qui permet de créer une fiction plus forte que la réalité. Mais là encore, l’idéologie prime sur l’instrument (la propagande) : la fiction d’un complot juif mondial ou celle d’une conspiration trotskiste peuvent devenir plus « logiques » que la réalité parce que « la texture entière de la vie » est réorganisée conformément à une idéologie.
Le parallélisme nazisme/communisme : Arendt privilégie le parallèle, la coïncidence entre nazisme et communisme même si elle est occasionnellement sensible à la différence par exemple entre le camp d’extermination nazi et le goulag soviétique. Cette quasi-identité est la thèse massive de l’ouvrage mais elle fut aussi la pomme de discorde, le nœud du caractère problématique du concept de totalitarisme. Pour tous les intellectuels cherchant à préserver l’image positive du « socialisme réel », le livre fut reçu comme un scandale. Dans le climat idéologique et géopolitique de la guerre froide, le livre fut aussi reçu comme une provocation c’est-à-dire comme une arme idéologique visant à discréditer le communisme.
- Le débat français sur l’œuvre d’Arendt
La critique de Raymond Aron : Dans Démocratie et totalitarisme, Aron poursuivit son projet global de comparaison des sociétés occidentales avec le monde communiste. Dans cette étude de type politique, il accepta de forger un idéal-type commun aux deux régimes suivant la méthode weberienne mais il refusa d’établir une stricte équivalence ou même de mettre nazisme et communisme sur un même pied. Ainsi qu’il l’écrivit : « passant de l’histoire à l’idéologie, je maintiendrai, au point d’arrivée, entre ces deux phénomènes, la différence est essentielle, quelles que soient les similitudes. La différence est essentielle à cause de l’idée qui anime l’une et l’autre entreprise ; dans un cas est à l’œuvre la volonté de construire un régime nouveau et peut-être un autre homme par n’importe quels moyens ; dans l’autre cas une volonté proprement démoniaque de destruction d’une pseudo-race ». En somme, bien qu’il n’ait aucune sympathie pour le communisme, Aron suggère que la comparaison systématique menée par Arendt estompe la singularité du régime nazi et le banalise quelque peu. Les idéologies ne sont pas seulement fonctionnelles ; elles ont leur contenu propre si bien qu’il est difficile de tenir pour équivalent une volonté de mort avec une volonté de justice qui dériva vers la destruction.
La défense d’Alain Besançon : Face à ce réquisitoire remarquable, Alain Besançon tenta de défendre Hannah Arendt en suggérant que la comparaison ne portait pas entre un projet démoniaque réussit et un projet humaniste échoué. Selon lui, la réalité de l’idéologie implique qu’il n’y a pas de référence à une idée de justice extérieure. Au contraire, l’idéologie est toujours juge et partie si bien que la justice est un élément à l’intérieur du système mu par la loi de mouvement. Le marxisme n’est qu’une enveloppe illusoire qui est démoniaque en tant que système.
Au total, l’argumentation d’Aron est forte : viser le mal comme une fin en soi ou l’utiliser comme moyen au sein d’une conception du bien n’est pas identique. Mais cela n’invalide pas le concept de totalitarisme : la logique de destruction au nom de la production d’un homme nouveau est présente dans les deux cas. Dans le nazisme, elle est officiellement assumée dès le départ tandis que dans le communisme, elle est, au démarrage, cachée dans les limbes d’une théorie de la justice sociale. Surtout le concept de totalitarisme apparaît comme « la condition de possibilité » du nazisme [Tassin, 1997]. En d’autres termes, on ne peut pas saisir la singularité du crime nazi qu’est la volonté proclamée de l’extermination des juifs (Shoah) sans présupposer une logique de destruction de l’humanité institutionnalisée qui est le propre du régime totalitaire.
C – Les critères du totalitarisme
- Des critères insuffisants
Une définition trop extensive : Face à cette conception restrictive, E.H. Carr proposa une définition extensive au terme de laquelle le totalitarisme désigne « la croyance selon laquelle un groupe ou une institution organisés, Églises, gouvernement ou parti, a un accès privilégié à la vérité » (E.H. Carr, The Soviet Impact on the Western World, New York, MacMillan, 1949, p 110). Une telle définition inclut donc toutes les époques et tous les régimes ; elle brouille les choses et devient inutile.
Une définition trop formaliste : La définition la plus célèbre reste celle proposée par Carl Friedrich et appelée le « syndrome en six points ». Selon celle-ci, le totalitarisme se définit par :
- une idéologie officielle embrassant la totalité de la vie ;
- un parti unique de masse mettant en œuvre cette idéologie et soumis à la volonté d’un seul homme (un dictateur) ;
- un contrôle policier terroriste au moyen d’une police secrète ;
- un pouvoir monopolisant les moyens de communication de masse :
- un pouvoir monopolisant les instruments de violence (les moyens de combat) ;
- un pouvoir contrôlant les organisations et en particulier les structures économiques afin de mettre en œuvre une planification et un contrôle centralisé de l’économie.
Les faiblesses internes : Cette définition souffre de faiblesses certaines : d’abord, elle s’attache à des traits formels et superficiels des régimes totalitaires ; ensuite, elle est statique et laisse donc dans l’ombre la « dynamique totalitaire », la place du changement, la dynamique interne du système ; enfin, elle est trop monolithique en survalorisant le rôle de l’idéologie et en ignorant les facteurs sociaux comme la mobilisation des acteurs sur une base collective.
La confusion avec les régimes autoritaires : L’insuffisance de cette définition se manifeste également par son incapacité à distinguer le totalitarisme de l’autoritarisme. Certes, la catégorie des « régimes autoritaires » est largement un regroupement de formes très diversifiées unifié seulement par des traits négatifs mais elle doit être soigneusement distinguée du totalitarisme pour que ce dernier est une valeur « scientifique ». Le régime autoritaire fonctionne aussi à la violence mais il recourt beaucoup moins à la mobilisation extrême par le biais d’une idéologie unanimiste ; il préserve une dose minimale de pluralisme et conserve les anciennes élites politiques et administratives. Le totalitarisme, au contraire, nie le pluralisme, impose sa propre élite et recherche une mobilisation totale et permanente des masses. Là où l’autoritarisme impose une reddition partielle aux hommes, le totalitarisme vise une reddition totale.
Sy.Les critères du totalitarisme doivent donc être recherché ailleurs c’est-à-dire à la fois dans la dynamique du système et dans la logique de l’idéologie.
- Des critères théoriques pertinents
Une logique de déshumanisation : Ensuite, le totalitarisme se caractérise par la volonté clairement affichée d’édifier un homme nouveau. En soi, cette prétention n’est pas originale et de nombreuses théories politiques ont proposé d’œuvrer au perfectionnement de l’homme. L’originalité du totalitarisme sur ce terrain réside dans les modalités : non seulement la fin justifie les moyens mais le totalitarisme suppose la négation de l’autonomie humaine en imposant à la place du réel une « surréalité idéologique » (Alain Besançon). Sous cet angle, le totalitarisme apparaît d’abord comme une entreprise de déshumanisation de l’homme, une entreprise anti-humaniste. L’individu doit être un objet malléable. L’homme est compris comme un rouage, une machine décervelée qui doit se conformer à une réalité présentée comme objective.
Sy.Ces traits idéaux définissent un modèle abstrait qui n’a pas un équivalent strict au plan historique et qui peut considérablement varier au plan empirique.
§2. Les interprétations du totalitarisme
Si l’on excepte les prises de position qui viennent conforter la vision de Hannah Arendt, comme celle d’Alain Besançon, deux usages de la notion d’État totalitaire peuvent être détectés : pour certains, la notion est légitime mais elle doit être corrigée ; pour d’autres, elle est en soi illégitime.
A – Les interprétations rectificatrices
Ce sont essentiellement les philosophes, les théoriciens du politique ou les défenseurs d’une histoire conceptuelle qui ont accepté la notion de totalitarisme. Tous ont cependant cherché à introduire des corrections. Parmi ceux-ci, citons Eric Voegelin, Karl Popper, Carl Friedrich, Friedrich von Haeyk, Claude Lefort, Cornélius Castoriadis, François Furet, Raymond Aron… Il n’est certes pas possible de tous les reprendre ici.
Ex.Karl Popper
Le philosophe libéral viennois Karl Popper publia en 1942 un ouvrage retentissant sous le titre La société ouverte et ses ennemis. Il tente d’éclairer les racines du phénomène totalitaire qu’il découvre dans deux déviations fondamentales de l’histoire intellectuelle de l’Occcident : d’une part, l’historicisme qui prétend maîtriser le mouvement de l’histoire laquelle devient prévisible et d’autre part, l’utopisme qui veut activement édifier un ordre neuf à partir d’une représentation idéale de la société. Popper incrimine aussi bien Platon, Hegel, Marx dont les pensées sont des systèmes fermés qui menacent les « sociétés ouvertes » au dialogue, à la diversité, au pluralisme. Selon la lecture poppérienne, le totalitarisme trouve donc son origine dans une attitude intellectuelle, une vision du monde et non pas dans les données sociales. Évidemment, la thèse de Popper est aussi une provocation : faire de Platon, de Hegel ou Marx des précurseurs du totalitarisme est philosophiquement douteux et historiquement un non-sens. Il n’en demeure pas moins que Popper souligne utilement le danger de toute prétention à la totalité, fusse dans des élaborations théoriques.
Le philosophe libéral viennois Karl Popper publia en 1942 un ouvrage retentissant sous le titre La société ouverte et ses ennemis. Il tente d’éclairer les racines du phénomène totalitaire qu’il découvre dans deux déviations fondamentales de l’histoire intellectuelle de l’Occcident : d’une part, l’historicisme qui prétend maîtriser le mouvement de l’histoire laquelle devient prévisible et d’autre part, l’utopisme qui veut activement édifier un ordre neuf à partir d’une représentation idéale de la société. Popper incrimine aussi bien Platon, Hegel, Marx dont les pensées sont des systèmes fermés qui menacent les « sociétés ouvertes » au dialogue, à la diversité, au pluralisme. Selon la lecture poppérienne, le totalitarisme trouve donc son origine dans une attitude intellectuelle, une vision du monde et non pas dans les données sociales. Évidemment, la thèse de Popper est aussi une provocation : faire de Platon, de Hegel ou Marx des précurseurs du totalitarisme est philosophiquement douteux et historiquement un non-sens. Il n’en demeure pas moins que Popper souligne utilement le danger de toute prétention à la totalité, fusse dans des élaborations théoriques.
Ex.Raymond Aron
Raymond Aron termina sa trilogie consacrée à la comparaison des sociétés libérales occidentales avec celles marxistes de l’Est par la dimension politique des régimes. Ce troisième volet intitulé Démocratie et totalitarisme combine une approche philosophique (les conditions d’un régime modéré) et une approche sociologique (la logique interne de chaque régime et ses traits principaux). Comme nous l’avons déjà dit, Aron défend Arendt lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle catégorie politique ou lorsqu’il s’agit de comparer le nazisme et le stalinisme mais il s’oppose à Arendt sur les origines et sur la nature des idéologies. Dans ce cadre, il préfère opposer les « régimes constitutionnel-pluralistes » (les sociétés libérales) aux « régimes monopolistiques » (les sociétés totalitaires). Le critère fondamental du totalitarisme devrait donc être l’existence d’un parti unique. Aron montre qu’un tel parti engendre de multiples conséquences ; la nature de l’État est changée et celui-ci se transforme en État partisan ayant recours à une idéologie forte pour justifier le monopole qui va se répandre dans la société aussi bien au niveau des moyens de communication, du contrôle de l’activité économique et sociale. Il est surtout conduit à mettre en place un appareil répressif pour éliminer l’opposition ou la rendre impuissante. Aron reconnaît que le régime monopolistique est un modèle abstrait (un idéal-type) ; la réalité est plus diverse. Elle va du cas pur et parfait qu’est le régime totalitaire à des cas moins nets comme la Turquie de Kemal Atatürk dont le parti s’adjugea un monopole provisoire mais y renonça plus tard et perdit le pouvoir par les élections. La lecture aronienne est datée : elle survalorise considérablement le facteur institutionnel au détriment du reste. A l’intérieur même du facteur institutionnel, elle privilégie exclusivement le mode d’organisation du pouvoir en délaissant son mode d’exercice. La division binaire entre démocratie et totalitarisme est également trop brutale tant il existe de multiples paliers entre les deux.
Raymond Aron termina sa trilogie consacrée à la comparaison des sociétés libérales occidentales avec celles marxistes de l’Est par la dimension politique des régimes. Ce troisième volet intitulé Démocratie et totalitarisme combine une approche philosophique (les conditions d’un régime modéré) et une approche sociologique (la logique interne de chaque régime et ses traits principaux). Comme nous l’avons déjà dit, Aron défend Arendt lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle catégorie politique ou lorsqu’il s’agit de comparer le nazisme et le stalinisme mais il s’oppose à Arendt sur les origines et sur la nature des idéologies. Dans ce cadre, il préfère opposer les « régimes constitutionnel-pluralistes » (les sociétés libérales) aux « régimes monopolistiques » (les sociétés totalitaires). Le critère fondamental du totalitarisme devrait donc être l’existence d’un parti unique. Aron montre qu’un tel parti engendre de multiples conséquences ; la nature de l’État est changée et celui-ci se transforme en État partisan ayant recours à une idéologie forte pour justifier le monopole qui va se répandre dans la société aussi bien au niveau des moyens de communication, du contrôle de l’activité économique et sociale. Il est surtout conduit à mettre en place un appareil répressif pour éliminer l’opposition ou la rendre impuissante. Aron reconnaît que le régime monopolistique est un modèle abstrait (un idéal-type) ; la réalité est plus diverse. Elle va du cas pur et parfait qu’est le régime totalitaire à des cas moins nets comme la Turquie de Kemal Atatürk dont le parti s’adjugea un monopole provisoire mais y renonça plus tard et perdit le pouvoir par les élections. La lecture aronienne est datée : elle survalorise considérablement le facteur institutionnel au détriment du reste. A l’intérieur même du facteur institutionnel, elle privilégie exclusivement le mode d’organisation du pouvoir en délaissant son mode d’exercice. La division binaire entre démocratie et totalitarisme est également trop brutale tant il existe de multiples paliers entre les deux.
B – Les interprétations critiques
Elles sont surtout le fait d’historiens et de sociologues souvent hostiles aux idées et emprunts d’un certain « culte des faits » (positivisme).
La sociologie politique nord-américaine spécialisée sur l’URSS s’est ainsi détournée du concept de totalitarisme après 1955 et l’a violemment critiqué. Elle s’appuyait sur la « théorie des groupes » pour mettre en valeur l’existence d’un « pluralisme limité » à l’intérieur des instances dirigeantes. Les élites auraient connu un processus de fragmentation engendrant l’émergence de groupes différenciés. Après la déstalinisation, elle mettra en avance l’ouverture relative des sociétés de l’Est par le biais de compromis pragmatiques, stratégie qui atteindra son apogée sous Brejnev. Plus récemment, la décomposition du système communiste constitua une sorte d’invalidation rétrospective de la notion de totalitarisme dans la mesure où il est apparu que l’État-Parti et son idéologie n’a jamais pu assurer son emprise sur la totalité de la société : soit une partie de la société civile avait échappé à cette emprise comme en Pologne avec Solidarnosc et l’Église, soit que l’aile progressiste du PC avait elle-même entamé la voie de la démocratisation comme en Hongrie ou en URSS avec Gorbatchev.
Les historiens également ont exprimé une virulente résistance à l’encontre du concept de totalitarisme. Cette attitude est devenue assez courante chez les spécialistes du national-socialisme par exemple chez Ian Kershaw, Denis Peschanski ou François Bédarida. La stratégie poursuivie est toujours la même : elle consiste à identifier des faits qui ne collent pas avec une des caractéristiques de la notion de totalitarisme puis de conclure à la nécessité de congédier le concept dans sa totalité. Par exemple, à partir de son travail sur les archives de la police politique en Bavière, Ian Kershaw montre combien le nazisme s’appuya sur les structures familiales, associatives ou religieuses. Il invalide ainsi une des explications d’Arendt selon laquelle le totalitarisme s’édifia sur les ruines d’une société dont les structures traditionnelles ne fonctionnent plus (elle évoque la « désolation »). Dans son célèbre ouvrage, Qu’est-ce que le nazisme ? Kershaw récidive : d’un côté, il affirme que la notion pourrait être gardée pour le seul régime nazi (seulement pour la période 1937-1938) mais il convient que cela est en grande partie superflu ; d’un autre côté, il déclare qu’un usage comparatiste du concept est possible à condition de lui ôter certaines de ses caractéristiques comme la thèse d’une « société de masse atomisée » ou l’idée de « pouvoir total »…
Sy.Si le concept de totalitarisme a des faiblesses réelles qu’il ne saurait être question d’ignorer, il paraît aberrant de vouloir se débarrasser du concept et de ses imperfections. Cette notion a, en effet, un avantage considérable : elle met en valeur une forme inédite de la politique dont la caractéristique centrale est une radicalité proprement inouïe. Pour la première fois dans l’histoire, un projet politique est institutionnalisé avec, au cœur de ce projet, la production de force d’un homme nouveau qui implique également un crime de masse c’est-à-dire une logique de destruction assumée.