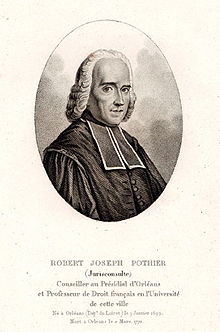1. La remise en cause des droits universels
Au XVIème siècle, au moment même où se construit en France la doctrine de l’absolutisme, les droits universels – droit canonique, droit romain – sont remis en cause.
1.1. Le déclin du droit canonique
Au XVIème siècle, le paysage européen est profondément transformé par la Réforme protestante, qui met fin à des siècles d’unité religieuse et politique.
Parti d’Allemagne (en 1517, Luther affiche à Wittemberg les « 95 thèses », affirmation publique d’une volonté de réforme du dogme), le mouvement se répand dans toute l’Europe, dont la carte politique se morcelle progressivement en fonction de critères religieux. Se dégage ainsi le principe Cujus regio ejus religio, selon lequel les populations sont tenues de suivre la religion de leur prince.
En France, une très forte minorité protestante (en majorité calviniste) apparaît et se développe dans l’Est et le Sud du royaume à partir des années 1530.
La diffusion du protestantisme a de profondes conséquences en matière juridique. En France, elle entraîne un nouvel essor et un renouvellement des principes gallicans.
En savoir plus
La doctrine gallicane, apparue au début du XIVème siècle lors de l’opposition entre le roi de France Philippe IV et le pape Boniface VIII, affirme l’indépendance temporelle de l’Eglise de France par rapport à Rome, et l’autorité du roi de France sur les affaires temporelles de l’Eglise.
En application de cette doctrine, en 1398 (en plein Schisme), un concile d’évêques français prononce une « soustraction d’obédience » vis-à-vis du pape, suspendant ainsi sur le territoire du royaume son pouvoir judiciaire, fiscal, et de nomination aux offices ecclésiastiques.
En juillet 1438, Charles VII, par une ordonnance connue sous le nom de « Pragmatique sanction de Bourges », proclame la supériorité du concile sur le pape, supprime les taxes imposées par le pape au clergé français, limite les possibilités d’appel juridictionnel au pape et restreint les droits du pape sur les bénéfices ecclésiastiques.
En application de ce texte, s’instaure donc une « Eglise gallicane », libérée de l’autorité temporelle du pape, mais placée sous l’autorité du roi de France, qui a ainsi affirmé sa compétence en matière de discipline ecclésiastique et de gestion des affaires temporelles de l’Eglise.
En premier lieu, l’autorité monarchique entend contrôler les normes émanant des autorités ecclésiastiques. Ainsi, les dispositions canoniques ne sont plus d’application automatique dans le royaume, c’est la monarchie qui leur donne force obligatoire. Le droit canonique élaboré en dehors du royaume de France (par le pape ou par un concile) ne s’applique que s’il a fait l’objet d’une réception, consistant le plus souvent en un enregistrement par le Parlement.
En second lieu, apparaît une nouvelle législation séculière concernant les matières ecclésiastiques : le roi légifère désormais dans le domaine religieux, participant ainsi à la création d’un droit ecclésiastique national, ne s’appliquant que dans les limites du royaume de France.
Des domaines entiers du droit, jusque là de la compétence de l’Eglise, passent dans la main du roi.
En matière de droit de la famille, le mariage est profondément transformé par l’intervention royale. Ainsi, l’édit de 1556 impose le consentement des parents et la publicité du mariage sous peine d’exhérédation. L’ordonnance de Blois de 1579 fait glisser le défaut de consentement des parents du civil au pénal, en assimilant un mariage conclu par des mineurs sans le consentement des parents à un rapt, dont l’auteur est passible de la peine de mort. Cette assimilation est encore renforcée par la grande déclaration de Saint-Germain de novembre 1639, qui en fait une présomption irréfragable
En outre, un édit de décembre 1606, en imposant aux tribunaux d’Eglise d’annuler les mariages contractés en violation des dispositions de l’ordonnance de Blois, fait d’eux les gardiens des textes royaux au détriment des dispositions canoniques contraires.
Le droit canonique matrimonial n’est donc plus un droit autonome, mais il est soumis aux injonctions monarchiques. La grande déclaration de Saint Germain de novembre 1639 est très claire sur les raisons idéologiques qui sous-tendent ce glissement de la sphère ecclésiastique à la sphère monarchique : « le mariage est le séminaire des états, la source et l’origine de la société civile, le fondement des familles qui composent la république ».
Parallèlement, le roi intervient pour contrôler, définir et limiter les compétences des juridictions d’Eglise. Etape ultime, par un édit d’avril 1695, l’ensemble des tribunaux de l’Eglise de France est soumis à la tutelle de la monarchie.
En savoir plus
Pendant toute la période moderne, du XVIème au XVIIIème siècles, la doctrine canoniste est loin d'être unanime sur la question du gallicanisme. Dès le XVIe siècle, elle se déchire en deux courants distincts, ultramontanisme et juridictionnalisme.
Les auteurs de l'ultramontanisme soutiennent le pape et l'absolutisme pontifical face aux législations canoniques nationales, en refusant, à des degrés divers, de considérer l'efficacité d'un pouvoir normatif des autorités séculières en matière canonique. Les auteurs partisans du juridictionnalisme (qui prend des formes différentes selon les pays : joséphisme, régalisme, gallicanisme...) soutiennent l'idée de droits canoniques nationaux propres à chaque État et dont les sources ne se limitent pas aux seules normes produites par l'Eglise catholique, mais incluent les normes séculières (lois des princes et des rois, coutumes nationales ou locales) ; ils sont également partisans d'une autonomie des différentes églises nationales vis-à-vis de Rome.
Cette opposition durable au sein de la doctrine entre ultramontanisme et juridictionnalisme conduit à resserrer la production doctrinale autour des questions cruciales dans cet affrontement : l'organisation interne de l'Eglise, les relations entre les Etats et l'Eglise, la répartition des compétences entre tribunaux ecclésiastiques et séculiers, les bénéfices, le mariage.
Ces nouveaux centres d'intérêt poussent à l'élaboration de nouveaux types d'ouvrages. En 1563, paraissent les Institutiones iuris canonici de GP Lancelotti. L'ouvrage est le point de départ décisif de nouveaux modes de raisonnement et d'exposition du droit canonique, marqués par une forte volonté de systématisation. Les auteurs se lancent en masse dans la rédaction de larges traités, qui ambitionnent d'expliquer par des principes généraux la totalité du droit canonique, plutôt que de commenter les différentes compilations canoniques. Le choix de la langue n'est pas neutre : les ultramontains tiennent au latin, quand les partisans du juridictionnalisme rédigent souvent leurs oeuvres en langue vernaculaire. En France, les auteurs gallicans ont également la particularité d'appartenir pour beaucoup d'entre eux au monde de la justice (avocat, parlementaire) et de produire, à côté de leurs ouvrages de droit canonique, des oeuvres de droit civil ou pénal.
1.2. La contestation du droit romain
A partir du XVIème siècle, le droit romain connaît en France une évolution complexe.
Il est tout d’abord profondément renouvelé sous l’effet conjoint de la pratique et de la doctrine.
Entre le XVIème et le XVIIIème siècle, la réception du droit romain est réelle, dans tout le Sud du royaume. La jurisprudence des cours méridionales (parlements, présidiaux) trouvent dans le droit romain des solutions adaptées aux Temps modernes, permettant de combler le silence ou le passéisme des coutumes, dans des régions qui ont par ailleurs souvent négligé leur mise par écrit lors des mouvements de rédaction et de réformation.
En en écartant l’application au profit des dispositions romaines, les juges méridionaux participent ainsi à la disparition de certaines pratiques coutumières. Le procédé est particulièrement visible en matière de droit des contrats et de droit des obligations, mais se retrouve aussi dans le domaine par excellence du droit coutumier qu’est le droit de la famille. Les juges méridionaux réactivent ainsi par exemple les mécanismes romains relatifs au régime dotal ou à la patriapotestas du père de famille.
La réception du droit romain est donc réelle, en particulier dans le Sud du royaume. En ce sens, il est possible de parler avec véracité du droit romain comme d’une « coutume générale » (comme le fait un édit d’Henri IV en 1609, qui autorise les juges à invoquer expressément le droit romain), ou d’affirmer comme Etienne Pasquier que « nous avons naturalizé en nostre France le droict civil des Romains », alors même que l’interprétation jurisprudentielle des dispositions romaines diverge selon les cours.
Le droit romain se renouvelle surtout sous l’effet de l’humanisme et du renouvellement de la pensée juridique qui se diffuse dans toute l’Europe à partir de la fin du XVème siècle.
En savoir plus
Sous l’influence de la Renaissance italienne, de la Réforme protestante et du développement de l’imprimerie, se développe au XVIème siècle une véritable révolution intellectuelle, qui prend le nom d’humanisme, et transforme profondément tous les champs du savoir humain.
L’humanisme cherche à concourir au développement de l’homme, par la reconstruction et la diffusion des savoirs. C’est donc un courant de pensée qui se préoccupe de l’homme dans son environnement et son histoire, et cherche à faire fructifier sa nature d’être pensant.
L’humanisme se caractérise par sa volonté de retrouver la pureté de la culture classique antique. Le Moyen Age (l’expression apparaît au XVIème siècle) apparaît aux yeux des humanistes comme une période obscure où l’héritage antique a été oublié. Il convient donc de renouveler la pensée en la débarrassant des apports médiévaux, qu’ils considèrent comme nécessairement corrompu et corrupteur.
Cette méthode, qui prend rapidement le nom de mos gallicus (par opposition au mos italicus, la méthode pratiquée par les bartolistes), est élaborée dans les universités européennes par quelques grandes figures.
En savoir plus
- André Alciat (1492-1550), juriste français venu enseigner en France, devient l’un des fondateurs et inspirateur de l’École de Bourges, foyer de l’humanisme français.
- La gloire de l’École de Bourges est Jacques Cujas (1522-1590). Il enseigne entre 1554 et 1590 à Bourges, Cahors, Valence, Turin et Paris. L’œuvre de Cujas est considérable. Il a reconstitué, dans une perspective historique, les écrits des grands jurisconsultes, en supprimant toutes les interpolations (c’est-à-dire les ajouts ou suppressions dus aux juristes d’époque postérieure) et en leur rendant leur portée originelle. Il est aussi l’auteur de commentaires approfondis sur les textes romains reconstitués. Ses travaux et son enseignement ont eu un grand retentissement à travers toute l’Europe.
Parmi les grands noms de l’humanisme juridique, on trouve aussi :
- François Le Douaren (1509-1559), Eguinier Baron (1495-1550) et Antoine Leconte (1517-1586), grandes figures de l’Ecole de Bourges, réputés pour leur sens didactique et leur attachement à la méthode d’Alciat, auteurs de commentaires de droit romain qui circulent dans toute l’Europe dès les années 1550 et vont profondément influencer leurs élèves, au premier rang desquels Hugues Doneau (1527-1591), dont les Commentarii de iure civili vont inspirer Grotius, et François Hotman (1524-1590), auteur de l’Antitribonien ou Discours sur l’étude des lois (1563).
- Jean de Coras (1512-1572), professeur à Toulouse, Valence, Ferrare, conseiller au Parlement de Toulouse, il est l’un des premiers à rédiger un commentaire en français de la législation royale (Des mariages clandestins et irréveremment contractés par les enfants de famille, 1557). Son De iure civili in artem redigendo (1557) s’inscrit dans la lignée des grands commentaires humanistes de son époque.
- Pierre Grégoire (1540-1597), professeur à Cahors, Toulouse, Pont-à-Mousson, il s’attache particulièrement au droit public, à travers une œuvre abondante dont les De republica libri sex et viginti (1596).
- Denys Godefroy (1549-1622) et son fils Jacques Godefroy (1582-1652), bâtisseurs de l’humanisme juridique genevois.
Leur idée est de reconstituer le droit romain classique, celui de la République et des premiers temps de l’Empire romain. Cette reconstitution passe par une approche historique, philologique, linguistique, en écartant la tradition médiévale, mais aussi le travail de reconstruction (à leurs yeux nécessairement artificielle) qui a présidé à l’élaboration des compilations justiniennes.
Cette méthode historique n’a pas pour seul objectif d’atteindre la connaissance d’un texte originel. Il s’agit aussi de parvenir à expliquer et interpréter ces textes par des outils conceptuels renouvelés. A partir d’une étude érudite et mettant en jeu tous les champs du savoir, les humanistes écartent les interprétations médiévales fondées sur une logique qui leur apparaît désormais désuète, réductrice et productrice de contre-sens. Ils lui préfèrent la reconstitution historique de la chronologie des textes : les contradictions entre dispositions juridiques romaines s’expliquent désormais par leur décalage chronologique, et donc par les problèmes et les contextes différents auxquelles elles se rattachent. Le droit romain n’est plus un bloc homogène dont il faut construire la cohérence par le recours au sic et non, au syllogisme ou à l’analogie ; il est une multiplicité de solutions juridiques accumulés dans le temps pour répondre à des problèmes spécifiques historiquement circonscrits. Replacer les concepts juridiques dans le contexte où ils ont été élaborés permet aux humanistes de les comprendre différemment de ce qu’avaient fait les hommes du Moyen Age.
Mais la persécution religieuse qui frappe les protestants en France conduit les grands noms du mos gallicus à se réfugier aux Pays-Bas. C’est de cette école romaniste hollandaise que la science juridique connaît au XVIIème siècle de nouveaux développements, centrés sur le droit des gens et le droit naturel.
L’un des plus importante figure de cette école est le Hollandais Grotius (Huigh de Groot, 1583-1645), théologien, humaniste, juriste, célèbre pour son ouvrage De iure belli ac pacis Libri Tres (1623). Il y expose un système de règles fondant les relations entre Etats, qu’il déduit du droit romain et de l’humanisme. Les relations entre Etats reposent donc désormais sur le droit et non plus la morale, sur un droit international, qu’il nomme du terme romain de ius gentium. Sa doctrine procède de l’idée qu’il existe un droit de nature, fondé sur la raison, commun à tous les hommes et qui doit être observé par tous.
Les idées de Grotius sont reprises à la génération suivante par l’École du droit naturel, dont le plus éminent représentant est Samuel Pufendorf (1632-1694, De iure naturae et gentium 1672), qui occupe à Heidelberg la chaire de « droit de la nature et de droit des gens ».
Les doctrines juridiques françaises sont très fortement marquées par cette École du droit naturel. Jean Domat (1625-1696) y puise l’idée que « le droit romain, ramenée à ses principes essentiels, représente l’expression la plus pure du droit naturel » (J.-L. Thireau). Son ouvrage le plus important, Les loix civiles dans leur ordre naturel (1689-1694) propose une systématisation complète du droit français, à partir d’une exposition logique fondée sur la raison et la nature. Ouvrage fondateur, les Loix civiles dans leur ordre naturel forme la « première synthèse juridique des Temps moderne » (J. L. Thireau).
Le renouveau du droit romain est donc à partir du XVIème siècle un mouvement de fond, qui transforme durablement la science juridique.
Mais, à la différence d’un grand nombre de pays européens, le renouveau de la science juridique a eu en France des conséquences particulières. Loin de renforcer l’autorité du droit romain, la renaissance humaniste en France lui a été paradoxalement dommageable.
La recherche érudite d’un droit romain purifié, la remise en cause systématique des textes, la condamnation des pratiques et interprétations anciennes ont conduit à déprécier l’autorité du droit romain autrement que comme modèle de pensée systématique et rationnel. Le droit romain en est devenu un outil difficilement utilisable par les praticiens. En insistant sur les aspects historiques, Les auteurs du XVIème siècle ont mis aussi en avant le caractère relatif du Corpus iuris civilis. Le droit romain apparaît désormais à beaucoup de juristes comme le droit d'une époque et d'une civilisation déterminée qui leur est fort éloignée. Ce relativisme conduit à nier au droit romain un caractère de droit commun universel, de jus commune comme avait pu le faire la doctrine médiévale. Le droit romain est désormais perçu comme le droit des anciens Romains, non comme le droit positif français.
Le renouvellement de la pensée juridique a conduit ainsi paradoxalement au déclin du droit romain comme source du droit positif.
Cette caractéristique explique que la réflexion juridique en France ait montré, dès la seconde moitié du XVIème siècle un second visage : celui de son attachement à la coutume et au développement d’un droit commun coutumier.