C'est durant les trois siècles de l'âge moderne (XVI
ème-XVIII
ème s.) qu'ont éclos les conditions nécessaires au décollage économique, culturel et étatique de l'Occident européen. Des nations entreprenantes, européennes, vont totalement bouleverser le paysage mental à partir du XV
ème s. (grandes découvertes, Renaissance, remise en cause de l'unité de la foi, naissance de l'imprimerie, genèse du sentiment national, etc.).
C'est dans ce contexte qu'émerge la France moderne. Une nouvelle organisation politique se forme à partir de l'héritage institutionnel médiéval qui préside à l'affirmation de l'État moderne. Cette stabilisation étatique est due à des intellectuels qui pensent la nature de la monarchie, de ses prérogatives, du statut du Roi, mais également à l'enrichissement des institutions, au développement de l'administration, à la transformation de l'organisation sociale (les sujets sont intégrés dans une communauté politique qui tend à les englober) et à l'uniformisation de l'assise territoriale (rattachement définitif des grands fiefs à la couronne).
L'État monarchique, en France, se construit autant par les idées que par l'exercice concret du pouvoir. Une certaine doctrine insiste ainsi dès les XVème et XVIème s. sur la notion de « puissance absolu » du roi (1), alors que le fonctionnement de l'État nécessite d'établir un équilibre entre les institutions et les forces politiques en présence (2).
La monarchie absolue est une forme de régime relativement récente qui prévaut en Europe aux XVII
ème et XVIII
ème s. Progressivement conceptualisé par certains penseurs du pouvoir et des juristes (1.1.), l'absolutisme, notamment en France, convoque tout un système de représentation visant à le magnifier (1.2.).
La théorisation du gouvernement royal est d'abord l'œuvre des légistes du Moyen Age qui adaptent en particulier le droit romain, pour renforcer le pouvoir du roi (cf. leçon 6). Les jurisconsultes médiévaux ont ainsi contribué à jeter les bases de la théorie du pouvoir royal, qui se forge en France dès la Renaissance. Un certain nombre de formules retirées de leur contexte connaissent ainsi, assez tôt, une belle fortune. Il peut s'agir de passages insistant sur la loi (lex), considérée comme supérieure à la coutume et envisagée comme émanant de la seule volonté du prince : c'est par exemple le cas de la formule quod principi placuit legis habet vigorem qui signifie « ce que le prince a décidé a force de loi ». Cette petite phrase connaitra une vraie fortune en Europe durant l'époque moderne, comme d'autres qui insistent sur la souveraineté du roi vis-à-vis des puissances étrangères. La formule « le roi est empereur en son royaume » (rex franciae in regno suo princeps est) souligne quant à elle l'indépendance politique du roi, tant face au Pape, que l'empereur et les rois étrangers. Le droit romain réinterprété devient ainsi, en France, une véritable école d'absolutisme.
Mais l'effort doctrinal visant à renforcer l'assise intellectuelle du pouvoir royal s'opère sans véritable souci de cohérence ; les légistes du roi se bornent à utiliser des formules frappantes qui affirment la puissance de ce dernier. Ce n'est qu'à partir des XVème et XVIème s. qu'une nouvelle pensée politique (1.1.1.) va jeter les bases intellectuelles qui permettront de structurer une véritable théorie de l'absolutisme (1.1.2.).
Si Claude de Seyssel (1450-1520) peut être considéré comme l'un des premiers théoriciens de l'absolutisme français parce qu'il en trace à la fois l'étendue et les limites (il parle de « monarchie tempérée »), c'est véritablement avec Machiavel (1469-1527) que l'Europe entre dans la modernité politique.
Claude de Seyssel présentant au roi Louis XII la traduction en français de Thucydide Fonds : Château de Versailles et de Trianon. Château de Versailles. Source : wikipédia - domaine public.
Claude de Seyssel (1450-1520), conseiller de la maison de Savoie, fait une brillante carrière aux parlements de Toulouse puis de Paris en qualité de Conseiller et Maître des Requêtes. Il passe alors au service du roi Louis XII. Également évêque de Marseille et archevêque de Turin, il est également un excellent commentateur du droit de Justinien. Il laisse deux ouvrages dans lesquels il fait l'éloge de l'équilibre des pouvoirs du gouvernement. Il écrit ainsi sous Louis XII son testament politique Les Louenges du Roy Louis XII (1508) ; puis pour François Ier le De la Grande Monarchie de France (1515 – 1519).
Observateur d'une société politique italienne divisée, Nicolas Machiavel mène une réflexion sur le sens de l'unité de l'État. Il en tire la conclusion que l'unité n'est possible que sous l'égide d'un prince puissant : « pas de prince, pas d'unification » dit-il dans son Prince, rédigé entre 1513 et 1514. Machiavel construit donc un système politique dont le Prince est le centre et c'est sur lui que Machiavel concentre toute sa réflexion. Le Prince, pour se maintenir au sommet, doit développer des vertus particulières, jusqu'alors inédites dans la culture royale : il doit être efficace et égoïste, fort et calculateur, insensible et cynique, rusé et hypocrite. La place éminente du prince le situe ainsi au dessus du commun et l'affranchit de la morale traditionnelle. En bref, ces qualités hors normes justifiées par la raison d'État selon Machiavel – même si l'expression n'existe pas encore –, ouvrent la voie à l'absolutisme.
Nicolas Machiavel (1469 – 1527) gravure de Cipriani, Galgano (1775-1857) d’après Sandi di Tito. Source : BNF - domaine public.
Nicolas Machiavel naît à Florence en 1469 et y meurt en 1527. Issu d'une famille aisée, il mène une carrière de haut fonctionnaire dans l'administration florentine (chancellerie). Il est obsédé par la question de l'unité, car l'Italie est divisée en cités-États et en partis politiques opposés (Guelfes et Gibelins). Il s'interroge sur le sens de l'unité de l'État et les moyens qui permettraient de construire cette unité.
Après Machiavel les intellectuels français vont à leur tour s'engager dans une réflexion de longue haleine sur les fondements du pouvoir et le statut politique de l'État monarchique. Ils sont les théoriciens de l'absolutisme français.
Au confluent de la vision de Claude De Seyssel (monarchie tempérée) et de celle de Machiavel (monarchie forte), le juriste et philosophe français Jean Bodin (1529-1596) donne une définition intermédiaire de la monarchie. Il s'agit pour lui de la forme de gouvernement qui incarne le mieux la souveraineté.
Les six livres de la République de Jean Bodin. Source : BNF - domaine public.
Jean Bodin, né en 1529 à Angers et mort en 1596 à Laon, est un jurisconsulte, philosophe et théoricien politique français, qui influença l'histoire intellectuelle de l'Europe par ses principes du « bon gouvernement » et son analyse fine de la souveraineté royale. Il est célèbre chez les juristes pour son ouvrage Les six livres de la République, publié en 1576.
Considéré comme l'introducteur du concept moderne de souveraineté, il considère cette dernière comme l'autorité entière et indépendante, sans laquelle un État n'est ni libre ni parfait. Avec Bodin la notion de souveraineté est dorénavant placée au centre des travaux des publicistes modernes. Dans ce sens, son ouvrage Les six livres de la République doit être considéré comme le point d'aboutissement du long travail des légistes qui cherchaient à donner une expression rationnelle à la théorie de la souveraineté. Dès lors l'absolutisme monarchique signifie que le roi est seul titulaire de la souveraineté et qu'il ne la partage avec personne. Cette souveraineté, parce qu'elle est absolue, perpétuelle et indivisible, constitue, selon le jurisconsulte, la principale force d'union et de cohésion de la communauté politique. Du reste, dans les guerres civiles de Religion qui minent l'Europe, beaucoup ne voient pas d'autre remède pour établir une paix durable que de s'en remettre à un pouvoir royal absolu, seul détenteur de la souveraineté.
Dans l'esprit de Bodin, l'État prendra alors plusieurs formes en fonction de qui détient la souveraineté (populaire, aristocratique, monarchique). On se doute que c'est la forme de l'État monarchique qui a sa préférence. L'État à gouvernement royal, ici, s'en remet pour son gouvernement à un seul homme, dans lequel les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) se confondent. En somme Bodin parachève les travaux commencés par les légistes médiévaux. Inquiet des malheurs de son temps, il voit dans la souveraineté le remède permettant au roi de rester au dessus des querelles. Celui-ci, grâce à la souveraineté, ne tient plus de personne puisque son pouvoir n'est ni temporaire, ni délégué. Il n'existe donc pas de monarchie mixte pour Bodin, mais une monarchie pure, support politique le mieux adapté à l'indivisibilité de la souveraineté. Pour lui, en effet, « La monarchie pure et absolue est la plus sûre des Républiques », République qu'il faut comprendre ici au sens d'État. C'est tout le sens de l'extrait donné ci-dessous.
Tx.Jean Bodin, Les six livres de la République (1576), (éd. Lyon, 1593, texte adapté) :
« I, 1. La république est un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine [...] Tout ainsi que le navire n'est plus que bois sans forme de vaisseau, quand la quille, la poupe et le tillac sont ôtés, aussi la République sans puissance souveraine qui unit tous les membres et partie d'icelle et tous les ménages et collèges en un corps n'est plus République [...]. — 9. La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République [...], elle n'a d'autre condition que la loi de Dieu et de la nature ne commande. Il faut que ceux-là qui sont souverains ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui et qu'ils puissent donner loi aux sujets et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. C'est pourquoi la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois et ce mot de loi emporte aussi en latin le commandement de celui qui a la souveraineté [...]. Aussi voyons-nous à la fin des édits et ordonnances ces mots : " Car tel est notre plaisir ", pour faire entendre que les lois du prince souverain, ores qu'elles fussent fondées en bonnes et vives raisons, néanmoins qu'elles ne dépendent que de sa pure et franche volonté [...]. Quant aux lois qui concernent l'état du royaume et l'établissement de celui-ci, d'autant qu'elles sont annexées et unies avec la couronne, le Prince n'y peut déroger, comme est la Loi salique, et quoi qu'il fasse, toujours le successeur peut casser ce qui aura été fait au préjudice des lois royales [...]. — 11. La première marque du prince souverain, c'est la puissance de donner loi à tous en général et à chacun en particulier, qui est incommunicable aux sujets [...]. Sous cette même puissance de donner et casser la loi sont compris tous les autres droits et marques de souveraineté [...], comme décerner la guerre ou faire la paix, connaître en dernier ressort des jugements de tous magistrats, instituer et destituer les plus grands officiers, imposer ou exempter les sujets de charges et subsides, octroyer grâces et dispenses contre la rigueur des lois, hausser ou baisser le titre, valeur et pied des monnaies [...]. — II, 1. Puisque nous avons parlé de la souveraineté et des marques et droits de celle-ci, il faut voir en toute République ceux qui tiennent la souveraineté pour juger quel est l'État [...]. Il n'y a que trois États ou trois sortes de République, à savoir la monarchie, l'aristocratie et la démocratie : la monarchie s'appelle quand un seul à la souveraineté [...] et que le reste du peuple n'y a que voir ; la démocratie ou l'état populaire, quand tout le peuple ou la plupart de celui-ci en corps a la puissance souveraine ; l'aristocratie, quand la moindre partie du peuple a la souveraineté en corps et donne loi au reste du peuple [...]. — 2. Nous avons dit que la monarchie est une sorte de République en laquelle la souveraineté absolue gît en un seul Prince [...] ; toute monarchie est seigneuriale ou royale ou tyrannique [...] La monarchie royale ou légitime est celle où les sujets obéissent aux lois du monarque et le monarque aux lois de la nature, demeurant la liberté naturelle et la propriété des biens aux sujets. La monarchie seigneuriale est celle où le prince est fait seigneur des biens et des personnes par le droit des armes et de bonne guerre, gouvernant ses sujets comme le père de famille ses esclaves. La monarchie tyrannique est celle où le monarque, méprisant les lois de nature, abuse des personnes libres comme d'esclaves et des biens des sujets comme des siens... ».
Après Bodin aucune argumentation ne fera l'économie de la théorie de la souveraineté, ce qui le situe au premier rang des théoriciens de l'absolutisme. La doctrine publiciste absolutiste qui lui succède va affiner et développer le concept de monarchie pure, en insistant sur la notion de souveraineté absolue. Les auteurs du XVIIème s. vont insister sur l'autorité indiscutée du monarque et sur l'extension de ses prérogatives. Le XVIIème s. se présente comme le siècle où vont culminer les thèses absolutistes : Guy Coquille et Charles Loyseau sous le règne d'Henri IV, Pierre Cardin le Bret et Richelieu sous celui de Louis XIII et encore Bossuet sous le règne de Louis XIV, incarnation même de l'absolutisme.
L'histoire juridique a retenu le nom du magistrat, Guy Coquille (1523-1603), contemporain de Bodin, qui écrit un traité (Institution au droit des François) publié en 1607, dans lequel il conteste l'efficacité du régime mixte et refuse l'idée d'une monarchie tempérée. Pour l'auteur absolutiste la souveraineté doit être toute entière contenue dans la personne du roi, d'où sa célèbre formule : « le roi est le monarque et n'a point de compagnon en sa majesté royale ». Après lui le magistrat de province puis bâtonnier de l'ordre des avocats à Paris, Charles Loyseau (1566-1627), considère que le roi est le seul détenteur de la puissance publique ; il emploie d'ailleurs la formule « puissance absolue » (plenitudo petestas) pour qualifier le pouvoir royal. Mais l'auteur du Traité des seigneuries (1608) ajoute au concept de puissance absolue le symbole de la couronne, censé représenter la souveraineté parfaite : « comme la couronne ne peut être si son cercle n'est entier, aussi la souveraineté n'est point si quelque chose y fait défaut ». Il en déduit par exemple que les justices seigneuriales ont été usurpées au pouvoir royal. L'autorité et le commandement doivent, en effet, demeurer dans la main du roi et, par délégation, dans celle de ses officiers.
Charles Loyseau (1566-1627), par Jaspar Isaac. Château de Versailles. Source : wikipédia - domaine public.
Guy Coquille (1523-1603), Louis Rochet, 1849. Tour de l'horloge de la ville de Decize (Nièvre, France). Source : Own Work - CC BY-SA 3.0 FR.
Mais les graves crises de la fin du XVIème et du début du XVIIème s. continuent de mettre en péril ce schéma autoritaire. Ce n'est que lorsque la remise en ordre est à peu près achevée que Pierre Cardin Le Bret (1545-1643), avocat au Parlement et conseiller du roi, publie son traité De la souveraineté du roi, en 1632. Pour Cardin Le Bret le roi est seul dépositaire de la souveraineté et elle ne pourrait exister et perdurer si un de ses attributs devait manquer. Pour ces raisons elle ne peut être partagée. C'est bien ce que rappelle le conseiller du roi lorsqu'il affirme que « la souveraineté du roi n'est non plus divisible que le point en géométrie ». Pour Cardin Le Bret, d'ailleurs, cette souveraineté, impartageable et indivisible, permet au roi de revendiquer un véritable monopole législatif.
Frontispice de l’ouvrage de Pierre Cardin Le Bret, De la souveraineté du roi, publié en 1632. Source : Google Livres.
A côté de ces approches conceptuelles de l'exercice de la monarchie, on trouve la vision concrète de Richelieu (1585-1642), qui combine réalisme et opportunisme. Richelieu est le conseiller du roi Louis XIII. Il avait été nommé en 1624 au Conseil du roi, avec le titre de « Chef du Conseil ». C'est dans son Testament politique, rédigé entre 1635-1640 et publié en 1688, qu'il déplore l'anarchie dans laquelle le royaume est tombé. Il rédige alors un programme de redressement du royaume qui consiste à ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous les sujets en leur devoir et relever le nom du roi à l'étranger.
Richelieu se révèle moins théoricien que pragmatique et développe ainsi une conception originale du gouvernement et de l'État. Il refuse par exemple toute collégialité dans l'exercice du pouvoir. Il se montre donc hostile aux états généraux et provinciaux, tout comme aux parlements dont il condamne les interventions fréquentes dans la vie politique. Pour autant le roi ne peut gouverner seul en permanence. Ainsi le cardinal lui conseille de s'entourer de quatre ministres et d'un principal ministre ; c'est à ce dernier que le roi devra confier ponctuellement ses affaires (théorie du ministériat).
Si Richelieu a contribué à restructurer l'État (administration, fiscalité), l'année de sa mort (1642) ouvre une nouvelle crise de l'autorité, qui aboutira à la Fronde en 1648. Définitivement matée en 1652, cette révolte a toutefois profondément marqué le futur roi Louis XIV. Celui-ci usera alors pleinement de son statut d'arbitre suprême dans le royaume. Son règne parachève en effet le concept d'absolutisme, auquel Bossuet associera l'élément de droit divin qui lui faisait défaut.
Depuis le Concordat de Bologne (1516) le roi de France a la haute main sur le clergé français. Il nomme les évêques et les abbés qui reçoivent ensuite l'investiture pontificale. C'est ce que l'on nomme la régale royale. Mais en 1673 un conflit éclate entre Louis XIV et le pape Innocent XI, car le roi cherche à étendre la régale. Le Pape condamne, mais rien n'y fait, et la plupart des évêques de France se rangent derrière le roi. En 1681 Louis XIV réunit l'Assemblée extraordinaire des évêques de France en leur demandant de rappeler dans une déclaration solennelle les grands principes des Libertés de l’Église Gallicane. Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704 ), qui vient d'être nommé évêque de Meaux, est chargé d'en rédiger le texte. Sous le titre Déclaration du clergé gallican sur le Pouvoir dans l’Église, le texte se compose de quatre articles, d'où le nom qui lui est habituellement attribué : Déclaration des Quatre Articles . Il s'agit d'une véritable apologie de l'absolutisme, en matière spirituelle notamment, et qui peut être résumée comme suit :
-
Les rois n'ont pas de supérieur au temporel et leurs sujets ne peuvent être déliés de leur serment de fidélité.
-
Les conciles sont supérieurs au pape.
-
Les libertés gallicanes doivent être protégées.
-
Les décisions des papes peuvent être réformées.
Plus tard Bossuet achève pour le dauphin la Politique tirée des propres paroles de l'Écriture Sainte (parution en 1709), ouvrage dans lequel il résume le dogme de l'autorité absolue en 3 propositions :
Tx.Bossuet,
Politique tirée de l'écriture sainte, liv. III (in
Œuvres..., éd. F. Lachat, Paris, 1864, t. XXIII, p. 533-537 ; J. Imbert, G. Sautel, M. Boulet-Sautel,
Histoire des institutions et des faits sociaux, 2, Paris, PUF, 1970, p. 179 sq.) :
-
1ère proposition : l'autorité royale est sacrée.
Dieu établit les Rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples [...]. Nous avons déjà vu que cette toute puissance vient de Dieu [...]. Les princes agissent donc comme ministres de Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C'est par eux qu'Il exerce son empire [...]. C'est pour cela [...] que le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même [...]. Il gouverne donc tous les peuples, et leur donne à tous leurs Rois. [...].
-
2ème proposition : la personne des Rois est sacrée.
Il paraît de tout cela que la personne des Rois est sacrée, et qu'attenter sur eux est un sacrilège. Dieu les fait oindre par ses prophètes d'une onction sacrée, comme Il fait oindre les pontifes et ses autels. Mais même sans l'application extérieure de cette onction, ils sont sacrés par leur charge, comme étant les représentants de la majesté divine, députés par la Providence à l'exécution de ses desseins. [...].
-
3ème proposition : on doit obéir au prince par principe de religion et de conscience.
Saint Paul, après avoir dit que le prince est le ministre de Dieu, concluait ainsi : " il est donc nécessaire que vous lui soyez soumis non seulement par la crainte de sa colère, mais encore par l'obligation de votre conscience ". C'est pourquoi il le faut servir, non à l’œil, comme pour plaire aux hommes, mais avec bonne volonté, avec crainte, avec respect, et d'un cœur sincère comme à Jésus-Christ [...]. Il y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu'on doit au prince. Le service de Dieu et le respect pour le Roi sont choses unies. Et Saint Pierre met ensemble ces deux devoirs : " craignez Dieu, honorez le Roi ". Le prince voit de plus loin et de plus haut ; on doit croire qu'il voit mieux, et il faut obéir sans murmurer, puisque le murmure est une disposition à la sédition.
L'évêque de Meaux conçoit son système de gouvernement dans le cadre de la monarchie héréditaire et absolue, mais dans un sens rigoureusement chrétien. Il rappelle ainsi que c'est Dieu qui a établi les rois et, les ayant fait ses ministres, c'est par son intermédiaire qu'ils règnent. Dès lors, enfreindre les ordres du roi c'est désobéir à Dieu. Comme on le voit il s'agit d'un anti-contractualisme, fondé sur l'origine divine du pouvoir : il y a obligation naturelle de régner pour l'un (le roi) et obligation naturelle de se soumettre pour les autres (les sujets). Pour ces derniers dès lors, servir et respecter l'État et être fidèle au roi, relève moins de l'acte de volonté que de l'obligation, et une obligation religieuse qui plus est. Cette analyse fait de Bossuet le grand théoricien de la monarchie absolue de droit divin.
Mais cet appareil doctrinal visant à magnifier le pouvoir du roi, aussi érudit soit il, manquerait de substance s'il n'était accompagné de tout un arsenal symbolique, insistant sur la majesté royale.
De plus en plus, depuis la Renaissance, le pouvoir royal se donne à voir ; il se met en scène. Durant la période moderne la France se définie comme une nation à travers l'imaginaire du corps symbolique du roi. Les arts sont mis à contribution pour traduire intellectuellement et émotionnellement cette conception (peinture, sculpture, ballets, opéra, théâtre, poésie, monnaies, architecture, urbanisme, etc.). De façon accrue aux XVIème et XVIIème s., le spectacle devient une nécessité liée au pouvoir. Ce spectacle se retrouve tant dans les rituels, la magnificence, la cour, que la religion royale.
Les rituels, d'abord, visent à faire apparaître le roi comme différent du reste des hommes. C'est le cas du sacre qui conserve un rôle majeur sous l'Ancien Régime, même s'il ne fait plus juridiquement le roi (instantanéité de la succession depuis le début du XVème s.). Il confère en effet à ce dernier les marques de l'approbation divine et le fait qu'il gagne en faste contribue à émouvoir et impressionner les sujets.
Sacre de Louis XVI, célébré à Reims le 11 juin 177. Source : BNF - domaine public.
Dans le même sens, les funérailles royales rappellent le caractère sacré du souverain et toute une symbolique insiste sur les deux corps du roi, son corps physique mortel et son corps mystique, celui de la monarchie immortelle. Mais sacres et funérailles sont des rituels rares ; la monarchie a donc recours à des rituels plus réguliers, comme les entrées de villes. Lors de ses voyages à travers le royaume, le roi est ainsi accueilli à la porte des villes par les magistrats qui lui remettent les clefs de la cité. En retour, le roi devait garantir les privilèges et les libertés de la cité. C'était toujours l'occasion d'une mise en scène grandiose de la personne royale.
Triomphante entrée du Roi et de la Reine à Paris, le 26 août 1660, Feuille, par Charles Cochin. Source : BNF - domaine public.
Avec François Ier, les rois adoptent les pratiques des Italiens comme le mécénat et le recours au spectaculaire. Les rois français deviennent bâtisseurs (châteaux de la Loire, de l'Ile de France, de Paris, etc.), tout autant que collectionneurs. Le recours au spectaculaire est constamment pratiqué : tournois, carrousels, ballets de cour, fêtes dynastiques. On constate une véritable stratégie de la magnificence qui atteint son apogée sous Louis XIV (Versailles, places royales, fêtes...) et qui vise notamment à impressionner les princes étrangers.
Le château de Versailles. Source : Own work - Licence de documentation libre GNU.
Charles-Nicolas Cochin, Bal masqué dit « bal des Ifs » donné pour le mariage du dauphin Louis de France le 23 février 1745. Source : BNF - domaine public.
La cour, bien sûr, participe du faste monarchique. C'est Henri III le premier qui l'organise, avant que Louis XIV n'en fasse un véritable instrument de gouvernement et un modèle de sociabilité. Le roi y voit du reste l'avantage, en plus de la grandeur et la magnificence, de fidéliser la noblesse. Au temps de sa splendeur, à Versailles, la cour compte environ 10 000 personnes et forme une véritable société, à tel point qu'elle possède un statut juridique particulier.
Le roi accompagné de sa Cour visite l'Hôtel des Invalides et sa nouvelle église (éd. Paris chez Nicolas Langlois, Rue St. Jacques à la victoire au coin de la rue de la Parcheminerie, 1707). Source : BNF - domaine public.
Mais cette politique n'est rendue possible que grâce à l'aura dont est entourée la personne royale. Celle-ci fait l'objet d'un véritable culte, fondé sur l'ostentation de sa personne. Le roi est ainsi en représentation permanente, afin de magnifier la fonction qu'il incarne.
Sy.Depuis la période médiévale et de façon importante depuis le XVIème s. des thèses doctrinales officielles cherchent à renforcer le pouvoir royal contre les pouvoirs concurrents, internes comme externes. Elles contribuent à imposer l'absolutisme comme système institutionnel. L'origine divine du pouvoir, son unité et son indivisibilité sont mis à profit pour réaliser ce projet. Mais au-delà de cet arsenal intellectuel, c'est tout un système de représentations qui est convoqué dans la fabrique de l'absolutisme. C'est dès lors un véritable complexe symbolique et savant qui sert à justifier le gouvernement monarchique français.
Mais la mécanique institutionnelle également renforce l'État. Elle assure à la monarchie un véritable équilibre fonctionnel.
A s'en tenir à une vision du pouvoir royal fondée sur une pleine puissance personnelle et exclusive, on pourrait croire le roi parfois tenté d'en abuser. Mais celui-ci doit au contraire tout mettre en œuvre pour éviter l'arbitraire et protéger les libertés. On dit d'ailleurs de son pouvoir qu'il est réglé et ce grâce à plusieurs garanties : religieuses, morales, juridiques, institutionnelles.
La religion et la conscience chrétienne du roi permettent de tempérer son action. Roi par la grâce de Dieu, le souverain est comptable devant celui-ci de la gestion de son royaume. Les auteurs expliquent que si le droit divin confère au roi des droits, il lui impose tout autant de nombreux devoirs. Bossuet rappelle cet impératif (v. texte supra).
Le droit naturel également doit guider les décisions du roi. C'est la loi commune de tous les hommes ; le roi ne peut sombrer dans l'arbitraire car il doit protéger les libertés personnelles et familiales, mais aussi les biens, la propriété privée et il doit en outre mener des guerres justes. Le roi est par ailleurs tenu de respecter les libertés des corps, des ordres et des provinces, tout comme
la constitution coutumière du royaume, composée des lois fondamentales. Il s'agit là d'un véritable socle normatif supérieur à la volonté royale et auquel le roi doit se soumettre (2.1.). En outre, même si en théorie le roi doit décider seul et statuer en dernier ressort, la pratique gouvernementale impose un cadre à son action. Il est ainsi invité à consulter le Conseil et les états généraux (ce n'est plus le cas dès 1614 toutefois) et provinciaux. Quant aux parlements et aux cours souveraines, ils peuvent également freiner son action. C'est toute la question des contre-pouvoirs qui est ici posée (2.2.). Cet ensemble complexe, à la fois moral, institutionnel et politique, assure l'équilibre fonctionnel de l'État.
Au Moyen Age, déjà, la royauté était réglée par un ensemble de règles, pour l'essentiel forgées empiriquement au gré des circonstances, et qui s'imposaient à la volonté du roi. Ces règles sont appelées à partir du XVIème s., « lois fondamentales du royaume ». Elles traitent pour l'essentiel, durant toute l'histoire monarchique, du statut de la couronne de France, c'est-à-dire tant sa transmission (primogéniture masculine, exclusion des femmes, majorité du roi, instantanéité de la succession, indisponibilité), que le statut du domaine royal (indisponibilité, inaliénabilité).
Les lois fondamentales sont tenues pour indisponibles. Cela signifie que le roi se trouve dans l'impossibilité d'y déroger et de les modifier, et ce, dès les premiers Capétiens (cf. leçon 6). Cela tient au caractère traditionnel des sociétés coutumières, telles que le sont la société médiévale et celle d'Ancien Régime, qui forgent avec le temps des lois intemporelles et inviolables, constituant le fondement statutaire de l'État monarchique. Il ne s'agit donc pas d'une constitution débattue par contrat, mais d'un statut imposé par la coutume. Les lois fondamentales ont ainsi trois caractéristiques essentielles ; elles sont traditionnelles, à valeur constitutionnelle et limitatives de l'autorité royale.
Nous ne reviendrons pas ici sur le corpus ancien (cf. leçon 6) ; retenons qu'en matière de lois fondamentales l'acquis de la période médiévale est considérable. Des innovations sont néanmoins perceptibles durant les derniers siècles de l'Ancien Régime.
On sait depuis le Moyen Age que la dévolution de la Couronne ne peut dépendre de la volonté du roi. La succession se trouve par avance réglée, la couronne est donc indisponible. Cette pratique régulièrement observée tout au long du XVème s. constitue un apport fondamental au principe de continuité de l'État. Elle rappelle que le fonctionnement des institutions ne peut pas être interrompu pour des raisons personnelles ou d'ordre successoral. Ainsi le roi ne peut ni abdiquer, ni contraindre un de ses descendants à renoncer au trône, ni modifier l'ordre successoral. Certains évènements clefs confirment ces principes.
L'épisode de la captivité de François Ier vaincu par Charles Quint et fait prisonnier à Pavie en 1525, redit l'interdiction faite au roi d'abdiquer. Alors tenu captif à Madrid, François Ier veut éviter au royaume les conditions désastreuses d'un Traité de paix. Il s'apprête donc à signer un édit d'abdication en faveur du dauphin. Mais le Parlement de Paris, sur le fondement de la règle d'indisponibilité, fait savoir qu'une telle abdication serait contraire aux lois fondamentales. Abdiquer serait en effet disposer de la couronne. François Ier doit dès lors revenir sur ses intentions.
Dans le même sens le roi ne peut pas modifier l'ordre successoral, notamment en se donnant des successeurs par légitimation. C'est pourtant ce que tente de faire Louis XIV au soir de sa vie, après le décès de la plupart de ses descendants directs (le dauphin son fils d'abord, puis le duc de Bourgogne fils aîné du dauphin, et enfin le fils aîné du duc de Bourgogne, le duc de Bretagne). Craignant pour sa succession, Louis XIV substitue donc sa propre volonté à la tradition monarchique. C'est par l'édit de Marly de juillet 1714 qu'il déclare ainsi princes du sang légitimes, et donc aptes à lui succéder, les deux fils adultérins qu'il a eu avec sa maîtresse, Mme de Montespan : le duc du Maine et le comte de Toulouse. Si du vivant du roi personne n'ose invalider la décision, à la mort du roi l'édit est déféré devant le conseil de régence et révoqué (édit de juillet 1717, ci-dessous). C'était réaffirmer l'interdiction de disposer de la couronne.
Tx.Édit de juillet 1717 (Isambert, Rec. gén. des anc. lois françaises, t. XXI, p. 141) :
« Louis [...] le feu roi, notre honoré seigneur et bisaïeul, a ordonné par son édit du mois de juillet 1714 que si, dans la suite des temps, tous les princes légitimes de l'auguste maison de Bourbon venaient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle serait en ce cas dévolue et déférée de plein droit à Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, et à Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, ses enfants légitimés, et à leurs enfants et descendants mâles à perpétuité, nés et à naître en légitime mariage, gardant entre eux l'ordre de succession et préférant toujours la branche aînée à la cadette, les déclarant audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang capables de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres [...]. Depuis cet édit [...] le feu roi [...] ordonna par sa déclaration du 23 mai 1715 que dans notre cour de parlement et partout ailleurs il ne serait fait aucune différence entre les princes du sang royal et ses dits fils légitimés et leurs descendants en légitime mariage et, en conséquence, qu'ils prendraient la qualité de prince du sang [...]. Nous savons avec déplaisir que la disposition que le feu roi [...] avait faite, comme il le déclare lui-même par son édit du mois de juillet 1714, pour prévenir les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans le royaume si tous les princes de son sang royal venaient à manquer, est devenue, contre ses intentions, le sujet d'une division présente entre les princes de notre sang et les princes légitimés, dont les suites commencent à se faire sentir, et que le bien de l'état exige qu'on arrête dans sa naissance. Nous espérons que Dieu, qui conserve la maison de France depuis tant de siècles et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir et que, la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi. Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix et, puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même ; nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et le salut de l'état et que, par conséquent, l'état seul aurait droit d'en disposer dans un triste événement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine et dont nous sentons que la seule idée les afflige : nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire si ce malheur arrivait et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion, où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée, notre intention étant de la conserver dans tous ses droits en prévenant même ses vœux comme nous nous serions toujours crus obligé de le faire pour le maintient de l'ordre public, indépendamment des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang ; mais, après avoir mis ainsi l'intérêt et la loi de l'état en sûreté et après avoir déclaré que nous ne reconnaissions pas d'autres princes de notre sang que ceux qui, étant issus des rois par une filiation légitime, peuvent eux-mêmes devenir rois, nous croyons aussi pouvoir donner une attention favorable à la possession dans laquelle nos très chers et très aimés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, sont de recevoir dans notre cour de parlement les nouveaux honneurs dont ils ont joui depuis l'édit de juillet 1714 [...]. À ces causes [...] révoquons et annulons ledit édit du mois de juillet 1714 et ladite déclaration du mois de mai 1715 : ordonnons néanmoins que nos très chers et très aimés oncles, le duc du Maine et le comte de Toulouse, continuent de recevoir les honneurs dont ils ont jouis en notre cour de parlement depuis l'édit du mois de juillet 1714, et ce en considération de leur possession et sans tirer à conséquence, comme aussi sans qu'ils puissent se dire et qualifier princes de notre sang, ni que ladite qualité puisse leur être donnée... ».
La période moderne ne connaît enfin pas d'innovation en matière de continuité du pouvoir royal. La pratique de l'instantanéité de la succession est bien observée désormais. Depuis les ordonnances du début du XVème s. (1403 et 1407) la continuité royale ne fait pas juridiquement problème. Seules les périodes durant lesquelles le roi est mineur risquent de troubler cette continuité, mais le système de la régence permet de résoudre cette difficulté. Les règles en ont d'ailleurs été fixées assez tôt, par l'ordonnance de Melun d'octobre 1374 qui complète celle de Vincennes du mois d'août 1374 concernant la majorité des rois. Le roi, dès lors, même mineur et représenté par le régent, est considéré dès son avènement comme le dépositaire exclusif de la souveraineté ; d'où l'adage « en France le roi est toujours majeur ».
Si, comme on le voit, il y a davantage confirmation des lois fondamentales anciennes durant la période moderne qu'innovation, il convient toutefois de mentionner qu'une règle nouvelle vient s'agréger au corpus à la fin du XVIe s : il s'agit de l'obligation de catholicité du roi. Il est une évidence que pendant tout le Moyen Age le roi est catholique. Mais l'Europe connaît une rupture de l'unité de la foi au début du XVIème s..
Le problème de la catholicité du roi va dès lors se poser après l'assassinat d'Henri III ; celui-ci disparaît sans enfant mâle, tandis que son frère, le duc d'Anjou, est déjà décédé lui aussi sans descendance. Par le jeu normal des règles de succession (masculinité et collatéralité), l'héritier désigné par la coutume est donc Henri de Navarre, chef de la maison de Bourbon, et de religion réformée ; il est du reste le chef du parti protestant, excommunié par le pape en 1585. Son accession éventuelle au trône soulève alors l'opposition farouche des catholiques (ligue). Les ligueurs avaient pourtant anticipé. Dominant l'entourage d'Henri III, ils avaient contraint celui-ci à promulguer le 19 juillet 1588 l'édit d'union. Ce texte établissait officiellement la règle d'après laquelle le roi, en France, devait être de religion catholique. Peu après, les États généraux de Blois ratifièrent le texte et lui donnèrent valeur de loi fondamentale (18 oct. 1588). À la mort d'Henri III (août 1589) les ligueurs s'appuient donc sur ce texte pour interdire la succession à Henri de Navarre ; il serait impossible, selon eux, de faire sacrer un protestant. Ils déclarent par conséquent le trône vacant et proclament roi, sous le nom de Charles X, le cardinal de Bourbon, archevêque de Rouen, oncle paternel d'Henri de Navarre. Mais il y a là une violation évidente des lois fondamentales, puisqu'il est interdit de disposer de la couronne. Pour autant le Parlement de Paris ratifie. Le sort veut cependant que le vieux cardinal meure en mai 1590. Le duc de Mayenne, chef de la maison des Guise, cherche alors à imposer sur le trône la fille de Philippe II roi d'Espagne, l'infante Claire-Isabelle, qui par sa mère est la petite fille du roi Henri II. Mais c'était le principe de masculinité qui menaçait, cette fois-ci, d'être violé. Les états généraux refusent donc de valider la proposition. L'impasse semble complète.
C'est du Parlement de Paris qu'émane finalement la solution. Par son arrêt Lemaistre ou arrêt de la loi salique (v. infra), le Parlement de Paris rappelle avec fermeté les principes applicables en matière de succession au trône de France : l'exclusion des femmes et l'impossibilité pour un prince étranger de monter sur le trône. Henri de Navarre est dès lors automatiquement désigné comme successible légitime : il est l'héritier nécessaire. Pour autant le Parlement prend acte du nouveau principe de catholicité. Henri de Navarre en tire toutes les conséquences et le 25 juillet 1593 il abjure sa foi. Il est sacré à Chartes le 27 févr. 1594 ; « Paris vaut bien une messe ».
Tx.Arrêt Lemaistre, ou arrêt de la loi salique, 28 juin 1593 (texte modernisé)
[remontrances faites par le Président Lemaistre, au nom du Parlement au duc de Mayenne, lieutenant général du royaume] :
« ... Ils dirent audit seigneur que la charge de leur députation consistait en deux points ; l'un et le premier concernant l'établissement de l'infante d'Espagne, l'autre concernant la nécessité du peuple. Quant au premier, il avait charge de lui remontrer que la conservation de l'état royal et couronne de France dépendait entièrement de l'observation des lois fondamentales de ce royaume, à l’entretenement desquelles messieurs du parlement, comme les premiers officiers de la couronne, étaient fort étroitement obligés, tant par l'institution du parlement que par le serment que chacun d'eux avait fait a ladite cour ; Que monsieur le duc de Mayenne n'était pas moins obligé [que le Parlement] a l'entretenement des lois fondamentales de ce royaume par [sa] qualité de lieutenant général de l'état royal et couronne de France, par laquelle la couronne lui avait été baillée en garde et dépôt seulement, et par le serment solennel qu'il avait fait en ladite cour dudit état de lieutenant général, par lequel il avait promis et juré solennellement de conserver l'état royal en son entier, garder et faire garder les lois de ce royaume, et qu'entre ces lois la première et la principale était la loi salique, celle par laquelle, depuis douze cens ans, la majesté et grandeur de la couronne avait été conservée en son entier, et par laquelle les femmes sont perpétuellement exclues de la couronne, quoiqu'elles soient originaires de France et les plus proches du roi dernier décédé ; Que cette loi avait été introduite, reçue et pratiquée en France dès la lignée de Clovis, premier roi chrétien, et confirmée par l'avis des princes et seigneurs de ce royaume du temps de Philippe de Valois, roi de France, a deux fins : La première, pour empêcher que la couronne ne tombât dans la main des étrangers, comme elle fut tombée plusieurs fois par mariage, si les femmes eussent été capables pour icelle ; La seconde, afin que les François, lesquels en valeur et magnanimité ont passé toutes les autres nations, ne fussent contraints de se soumettre a la domination des femmes ; le gouvernement desquelles, lorsqu'elles ont eu le maniement de l'état, non point comme reines de leur chef, mais a cause de leurs maris ou enfants rois des François, avoient toujours été funestes a la France et excité plusieurs séditions et guerres civiles en icelle... Que, par arrêts de la cour de céans, toutes les chambres assemblées, et prononcé le 22 décembre dernier, présent ledit sieur duc, et publié a son de trompe et cri public par les carrefours de cette ville, afin que pareillement il servit de loi, la cour avait jugé, verbis disertis, que l'assemblée des états généraux, publiée en cette ville, ne tendait point a faire tomber l'état royal et couronne de France en mains des étrangers, ainsi afin de procéder a la déclaration et établissement d'un roi très chrétien, catholique et français, selon les lois du royaume ; Que l'établissement de l'infante d'Espagne, princesse étrangère, fille d'un roi estranger, née en pays étranger et y demeurant, était tant contre les lois de France publiées contre les étrangers, que contre la loi salique, contre la déclaration de monsieur de Mayenne et contre ledit arrêt du 22 décembre ; Qu'outre que cet établissement de princesse étrangère était contre les lois, arrêts et déclarations, il ne pourrait être autre que funeste a la France, pour prolonger ou plutôt continuer et perpétuer la guerre, et enfin ruiner le parti de l'union... Que, pour ces considérations et plusieurs autres, la cour, par son arrêt de lundi dernier, avait ordonné que remontrances lui seraient faites afin d'empêcher, par l'autorité a lui commise, que, sous prétexte de la religion, la couronne de France ne fut transférée en mains d'un prince ou princesse étrangers. Et néanmoins aurait par le même arrêt des à présent déclaré tous traités faits ou à faire, pour l'établissement d'un prince ou princesse étrangers, nuls et de nul effet et valeur, comme fait contre et au préjudice de la loi salique et contre les lois fondamentales de ce royaume ; le priait de la part de ladite cour, d'y tenir la main ».
Au-delà de la succession au trône de France, la continuité de l'État s'exprime aussi au regard de la politique monarchique en matière de sauvegarde du domaine. En la matière l'édit de Moulins de février 1566 constitue un document majeur. Ce texte confirme le contenu du domaine (distinction entre domaine fixe et casuel), consacre le principe d'inaliénabilité et en limite strictement les exceptions.
Le principe d'inaliénabilité, qui a été conservé dans le droit public contemporain, consiste à protéger le domaine contre les risques de dispersion. Avant 1566 aucun texte n'interdit expressément, en effet, d'aliéner une partie du domaine ; toutefois le principe d'inaliénabilité était inséré dans le serment du sacre (depuis Jean Le Bon). Le roi doit donc se comporter comme l'administrateur du domaine de l'État monarchique ; en aucun cas il est assimilable à un propriétaire. Il doit tout mettre en œuvre pour l'enrichir voire, a minima, en assurer l'intégrité. Des exceptions sont néanmoins admises ainsi que le rappelle l'édit de Moulins : « le domaine de notre couronne ne peut être aliéné qu'en deux cas seulement, l'un pour apanage des puînés mâles de la maison de France... l'autre pour aliénation à deniers comptants pour la nécessité de guerre... » (art. 1).
Le corpus des lois fondamentales montre en quoi la monarchie est constitutionnellement réglée dès le XVIème s. Les lois fondamentales constituent un ordre statutaire qui s'impose au roi pour assurer, au-delà de sa personne, l'existence et la pérennité de l'État. Dans le même temps le jeu institutionnel et politique assure un certain équilibre dans l'exercice du pouvoir monarchique.
Le roi, pour bien gouverner, doit consulter les organes compétents. Ces organes s'autorisent de leur côté à contrôler la décision royale, en toute légalité (A). C'est une conséquence de la mécanique monarchique en perpétuelle recherche d'équilibre. A cet équilibre institutionnel s'ajoute la contestation politique constante, ce qui relative l'idée d'arbitraire et vivifie, sans contradiction, le régime monarchique (B). Au XVIIIème s. la contestation atteint toutefois un seuil critique et pousse le roi dans ses ultimes retranchements : c'est la réaction (C). Ce triptyque consultation, contestation, réaction fait en quelque sorte système et constitue le contre-pouvoir nécessaire à la vitalité monarchique.
Consulter et demander conseil est, pour le roi, une pratique ancienne qui remonte au Moyen Age, période durant laquelle le prince a peu d'emprise sur le royaume et doit établir un consensus pour que ses décisions soient respectées et exécutées. C'est la raison pour laquelle le monarque prend soin, le plus souvent, de consulter ceux à qui ses décisions sont destinées. Cet usage s'inscrit si durablement dans la tradition gouvernementale royale que l'on retrouve l'idée, durant la période moderne, qu'un contrôle peut et doit être exercé par les assemblées représentatives (1) et les cours souveraines (2), sur les décisions du roi.
Dans l'ancienne France tous les ordres et les corps constitués peuvent faire entendre leur voix et défendre auprès du roi leurs « libertés et privilèges », dans le cadre d'assemblées convoquées par le roi. C'est en leur sein que les sujets expriment leurs vœux et doléances et que le roi y donne suite, sous forme législative ou réglementaire. Il existe plusieurs forment d'assemblées : seules celles représentant l'ensemble du royaume (états généraux, assemblées de notables) et celles représentant un « pays » ou une province (états provinciaux, états particuliers) seront étudiées dans le cadre de cette leçon.
Les état généraux prennent leur forme moderne en 1484 (règne de Charles VIII). Il s'agit d'une représentation des ordres de la communauté politique et ils ont pour objet, à ce titre, de défendre l'intérêt particulier de leur ordre.
En savoir plus : Les membres des états
Les membres des états sont élus et disposent d'un mandat impératif. Ils consignent ainsi les désidératas de leurs mandants dans des cahiers de doléances. Les députés siègent et votent par ordre, chaque ordre siégeant et votant séparément. Comme on sait, les états généraux ne reflètent pas la réalité sociale et démographique du royaume, puisque le clergé et la noblesse constituent à peine plus de 1 % de la population. La fonction première des états au Moyen Age est financière, puisqu'ils doivent voter les impositions accordées au roi (consentement). Mais durant la période moderne les états perdent cette capacité et ne parviennent pas à obtenir le droit de consentir à l'impôt. Aucun impôt nouveau ne sera ainsi autorisé par un vote préalable des états. On comprend par là que la fonction financière de ces assemblées décline durant l'époque moderne. Elles se cantonnent alors à leur mission de représentation, en se faisant la chambre d'écho des doléances des sujets.
Tenue des états généraux du Royaume sous le règne du roi Louis XIII (Herisset graveur et Delamonce dessinateur, s.d.). Source : BNF - domaine public.
Instrument de médiation entre le roi et ses sujets, c'est de cette façon que les états généraux apportent leur contribution au bon gouvernement du royaume et remplissent leur devoir de conseil. Si la doctrine – à l'exemple de Guy Coquille qui en fait le « premier établissement de la monarchie », – insiste sur le rôle politique des états généraux, force est de constater qu'en pratique ils ne disposent d'aucune autonomie : ils sont convoquées par le roi librement (ils ne le seront plus à partir de 1614) ; ils ne disposent pas de leur ordre du jour ; et la monarchie refusera toujours que les cahiers de doléances aient force de loi.
Tout comme les états généraux, les assemblées de notables participent du mode de gouvernement « par Grand conseil ». Mais à la différence toutefois des premiers, les secondes ne formulent que des avis pour soutenir l'action royale et gouvernementale. A cet effet leurs membres ne sont pas élus mais choisis au sein de la notabilité technocrate, généralement favorable au roi. Ces assemblées ont été convoquées à douze reprises par le roi, entre 1506 et 1788, pour des motifs variés comme la réaffirmation du droit public du royaume (assemblée de 1527 relative à la nullité du traité de Madrid), des propositions de réformes (assemblées de 1583 sur le redressement économique, de 1617 sur la suppression de la vénalité des offices, de 1626 sur le développement de la marine et de l'enseignement, etc.) ou la création d'impôts nouveaux (assemblée de Rouen de 1596 et celles de 1787 et 1788 sur la crise financière).
Les états provinciaux enfin – et dans un sens et une forme proches des états particuliers – ont une composition qui ressemble à celle des états généraux. Les trois ordres y sont en effet représentés et ils délibèrent et votent séparément. Dotés d'attributions administratives et fiscales, le roi les convoque régulièrement dans certaines provinces. Ils consentent au montant de l'impôt, gèrent sa répartition et surveillent sa perception, avant toutefois d'être en partie remplacés en la matière au XVIIème s. par les officiers royaux, le roi souhaitant établir, dans un souci de rationalisation, une fiscalité directe dans la plupart des provinces (système des élections). Ce mouvement provoque le déclin de nombreux états provinciaux au XVIIème s.. Organes de grand conseil par ailleurs, ils veillent à la défense des particularismes locaux (cahiers de vœux). Certains états parviendront à résister au processus de centralisation monarchique (Bourgogne, Bretagne, Languedoc, Provence) et prospéreront au XVIIIème s. Ils conserveront jusqu'à la fin de l'Ancien Régime leurs fonctions traditionnelles (vote de l'impôt, devoir de conseil, administration générale de la province notamment en matière fiscale et de travaux publics).
Bien que Louis XIV ait voulu substituer l'expression « cours supérieures » à celle de « cours souveraines », nous retiendrons la seconde pour plus de commodité. On recense cinq sortes de cours souveraines : les parlements, les chambres des comptes, les cours des aides, le Grand Conseil et les cours des monnaies.
Cours de justice, les parlements constituent le degré supérieur des juridictions ordinaires (présidiaux, bailliages, sénéchaussées, prévôtés, etc.) Ils rendent ainsi la justice en dernier ressort, au nom du roi. Mais ils contrôlent également la validité des actes royaux par l'exercice du droit d'enregistrement (vérification, enregistrement, publication), formulent parfois des remontrances et se prononcent également sur les affaires politiques graves (régence). Inamovibles à partir du XVème s., les magistrats développent rapidement un esprit de corps et défendent leur indépendance, ce qui fait des parlements un véritable contre-pouvoir (cf. infra 2.2.2.2).
D'origine médiévale et issue du démembrement de la curia regis comme les parlements, la Chambre des comptes devient une cours souveraine autonome au début du XIVème s. (cf. infra, leçon 6). Les chambres des comptes vont alors se multiplier durant la période moderne et on en compte neuf en 1789. Elles ont essentiellement pour mission le contrôle de la comptabilité publique et la conservation du domaine royal.
Les cours des aides, juge du contentieux fiscal, apparaissent avec la généralisation des impôts au XIVème s. Elles se développent par la suite avec l'accroissement du contentieux fiscal et l'extension du royaume. Il existe quatre cours distinctes en 1789.
Le Grand Conseil se détache du Conseil du roi tardivement, devenant une juridiction distincte seulement à la fin du XVème s. Ses compétences sont variables, mais il juge essentiellement les affaires que le roi retire aux parlements. Il traite aussi les causes bénéficiales ainsi que les conflits de compétence entre les présidiaux. Cela en fait le plus souvent un soutien de la royauté, notamment contre les parlements au XVIIIème s.
Érigée en cours souveraine en 1552, la cour des monnaies dirige et contrôle la fabrication des monnaies. Elle est également la juridiction suprême, au civil comme au criminel, des affaires intéressant les monnaies et les métaux précieux.
C'est sur le fondement du principe ancien du gouvernement « par grand conseil » que les cours souveraines s'autorisent à intervenir dans la vie politique du royaume et à exercer une forme de contrôle de l'action royale. Les magistrats des parlements s'estiment ainsi souvent mieux avisés que le roi lui-même et n'hésitent pas à lui prodiguer des conseils pour le préserver d'un entourage parfois mal intentionné. Cette attitude contient du reste en germe l'opposition parlementaire qui affectera le règne de Louis XV (cf. infra 2.2.2.2).
Les cours souveraines contrôlent par ailleurs les décisions du roi par l'exercice du droit d'enregistrement et celui de remontrance. La procédure de validation des actes royaux impose, en effet, qu'aucun acte expédié sous forme de lettre patente (lettre ouverte) ne devienne exécutoire tant qu'il n'a pas été vérifié par une cour (droit d'enregistrement). Si une cour considère que lors de la vérification l'acte menace les intérêts du roi et de l'État, elle peut refuser de l'enregistrer. Elle est alors libre, soit de modifier de l'acte (sans pour autant affecter l'esprit du texte), soit de présenter au roi des observations portant sur la substance de l'acte, sous la forme de remontrances. Le roi peut néanmoins passer outre et imposer sa volonté en utilisant diverses techniques (lettre de jussion, lit de justice. V. infra). Comme on le voit, droit d'enregistrement et remontrances constituent les instruments procéduraux, ordinaires et légaux, de limitation de l'arbitraire royal. Ils sont censés permettre aux cours souveraines de participer à la décision royale.
Pour autant on observe une certaine marginalisation de la consultation et du contrôle sur la période. Entre le XVIème et le XVIIIème s. certaines assemblées consultatives déclinent (états provinciaux). Beaucoup de ces formations, privées de leurs attributions principales, sont désertées par les élites naturelles du royaume ou sont étroitement encadrées par les commissaires du roi. Les états généraux se transforment quant à eux en « une institution de crise » (Barbiche) et ne sont réunis ou consultés que durant les grandes périodes de troubles. Le recul des formes traditionnelles de consultation n'est pas constant sur la période et l'on observe que les mouvements de flux et de reflux correspondent au va et vient entre périodes de crises (régences, fin du XVIIIème s.) et période d'affirmation de l'autorité royale (règnes de Louis XIII, de Louis XIV). Les états généraux ne sont par exemple plus consultés de 1614 à 1789. Ce phénomène s'explique également par le mouvement de centralisation monarchique, mais également par l'inefficacité et parfois l'incompétence des députés. La croissance de l'État, l'administrativisation du mode de gouvernement dès la fin du XVIIème s. impliquent un degré de professionnalisation et spécialisation qui échappe à ces derniers. Dans le même sens, durant le XVIIème s., la capacité de contrôle des cours souveraines diminue. Le pouvoir royal cherche à réduire le pouvoir d'intervention des cours souveraines dans les affaires de l'État et limite certaines d'entre elles à leur office de justice ordinaire (parlements). Louis XIV encadre par exemple le droit reconnu aux cours souveraines d'intervenir dans la procédure législative. Il restreint rigoureusement le droit de remontrance en 1667 (ordonnance civile, art. 2 et 5, tit. I) et à nouveau en 1673 (déclaration du 24 février). Ce droit sera restauré en 1715 durant la régence de Philippe, marquant le début d'une opposition parlementaire qui couvrira tout le XVIIIème s. mais qui s'inscrit dans une longue tradition contestataire.
La contestation est une tradition politique en France. On la retrouve sur toute la période, du XVIe avec la doctrine monarchomaque au XVIIIème s. avec les idées nouvelles (1). Mais le XVIIIème s. demeure néanmoins un siècle décisif en la matière, qui voit notamment certaines institutions se retourner contre le pouvoir royal ; c'est le cas avec les magistrats parlementaires lors des dernière décennies du siècle. Il en résulte de graves convulsions politiques (2).
Si, comme cela a été dit plus haut, une doctrine soutenant l'absolutisme royal s'est progressive forgée depuis la fin du Moyen Age, une doctrine concurrente, contestataire celle-là, a également fait entendre sa voix. Au cours des guerres de religion, en effet, des extrémistes catholiques et protestants n'hésitent plus désormais à critiquer l'institution royale. On voit dès lors émerger des écrits hostiles au roi, qui tentent d'en limiter le pouvoir et le champ d'action. Ces thèses réductrices de l'autorité royale ont une origine médiévale. Déjà au XIIIème s. St-Thomas d'Aquin précise que Dieu, lorsqu'il a établi le pouvoir, l'a donné à la multitude : c'est donc la nation qui a reçu le pouvoir de Dieu, en dépôt. Dans le cadre du gouvernement monarchique le pouvoir du roi vient dès lors de Dieu, mais par l'intermédiaire du peuple (omnis potestas a Deo per populum). Thomas d'Aquin en tire la conséquence de l'existence d'un pacte social, par consentement du peuple. Durant les guerres de religion, les théoriciens protestants, que l'on nomme « monarchomaques », vont restaurer cette théorie en proclamant l'origine contractuelle du pouvoir. Ils considèrent qu'il convient de résister au roi qui ne respecte pas ses devoirs et qui outrepasse ses droits. Parmi les monarchomaques protestants il faut retenir les noms de François Hotman (1524-1590), professeur de droit et diplomate convertit au protestantisme en 1547, et Théodore de Bèze (1519-1605), successeur de Calvin, théologien, poète et dramaturge, chef des églises réformées de France.
François Hotman (1524-1590). Source : http://www.nndb.com/people/330/000103021/francois-hotman-1-sized.jpg
Hotman développe dans son ouvrage Franco-gallia (1573) la thèse selon laquelle le roi en France est élu. Il se fonde pour cela sur les anciens usages des rois francs qui devaient leur couronne à l'élection et partageaient le pouvoir avec des assemblées (plaids), qu'il assimile au peuple pour intégrer l'élément populaire dans l'exercice du pouvoir. C'est ce montre que l'extrait donné ci-après :
Tx.Francogallia (1573). Deuxième édition : Libellus Statum verteris Rei publica Gallicae, tum deinde a Francis occupatam describens (1574). Traduction française : La Gaule française, Fayard, Paris, 1991 (chap. I, extrait).
« Il faut donc entendre que pour l'heure, la Gaule n'était point toute entièrement sujette à la domination et autorité d'un seul, qui la gouvernant en titre de roi, ni ne mettait le gouvernement entre les mains d'un petit nombre des plus notables et des plus gens de bien, mais toute la Gaule était départie en cité ou république. C'est que tous les ans, en certains temps de l'année, elle tenait une diète et assemblée générale de tout le pays où ils délibéraient les affaires d'État et concernant le bien universel et la chose publique ».
La thèse d'Hotman revient à affirmer que le pouvoir royal est d'origine populaire ; le peuple ayant, par un contrat tacite, accepté de déléguer au roi une partie de son pouvoir. Mais le peuple n'a pas pour autant abandonné la totalité de sa souveraineté ; le roi se doit en effet de consulter régulièrement les états-généraux. Dans la pensée d'Hotman, le roi est placé sur le trône pour assurer le bien du peuple. La mission royale est donc contractuellement définie. Si le souverain ne respecte pas ce contrat en enfreignant la loi divine et en violant la loi civile, il est considéré comme un tyran et le peuple a le droit de lui résister. Dans le système d'Hotman la monarchie apparait comme un régime mixte. Il est d'ailleurs possible, selon lui, de mette en place un tel régime via les États-généraux qui assurent la continuité avec les assemblées de l'époque franque, en représentant la nation toute entière.
Théodore de Bèze de son côté limite aussi l'absolutisme monarchique, mais en se référant davantage au droit naturel et à la contractualisation des rapports entre le roi et son peuple. Pour lui, en effet, le roi ne tient son pouvoir que du consentement du peuple et ce consentement est à la base d'un contrat fondé, à l'origine, sur la bonne foi et la raison. Ce contractualisme se retrouve d'ailleurs dans la promesse du sacre, où le roi s'engage à respecter les lois fondamentales. À partir de là le souverain est lié par ces lois qui définissent en partie sa fonction et lui sont supérieures.
Portrait de Théodore de Bèze par Cl. Cornelis Duysend (XVIIème s.). Source : BNF - domaine public.
Cette tradition contestataire ne se limite pas bien sûr au XVIème s. et perdure jusqu'au XVIIIème s., après les épisodes frondeurs bien connus du XVIIème s.. Durant le XVIIIème s. on observe des tensions de plus en plus fortes dans la vie politique. Depuis le règne de Louis XIV, les contrepoids traditionnels (lois fondamentales, États généraux et parlements) ne jouent plus leur rôle efficacement. Des idées nouvelles se développent qui tendent à remettre en cause l'absolutisme monarchique. Certains penseurs se montrent, par exemple, favorables à l'absolutisme éclairé. Sans remettre en cause le monopole royal du pouvoir, ils déclarent que celui-ci doit se mettre au service de causes considérées comme nobles (améliorer la condition des individus, assurer leur liberté, sauvegarder leurs droits individuels). Mais certains auteurs vont plus loin. C'est le cas Montesquieu (1689-1755) qui, dans son Esprit des lois (1748), dissocie avec le principe de séparation des pouvoirs ce que le système monarchique français concentre. Il considère que la puissance législative doit revenir à des représentants réunis dans deux chambres (bicamérisme), que la puissance exécutive doit rester au roi et que le pouvoir judiciaire doit être exercé par les cours souveraines.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (1689-1755), portrait par Charles-Philippe Campion de Tersan (1736-1819). Source : BNF - domaine public.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) de son côté va plus loin, en ce sens que son Contrat social (1762) bouleverse les bases mêmes de la souveraineté. Selon le philosophe genevois, toute société est fondée sur un pacte (tacite ou solennel) entre les individus. L'individu ne fait partie de la société qu'en raison de ce pacte librement conclu (accord de volonté). Mais en s'associant ainsi les hommes n'en renoncent pas pour autant à leurs droits, qu'ils tiennent de la nature ; le pacte ainsi conclu entre eux est là pour garantir ces droits. On voit que là où un Montesquieu se montre partisan d'un partage du pouvoir, un Rousseau, lui, modifie totalement le fondement du pouvoir, qu'il rattache à la volonté des individus pris collectivement. La souveraineté, chez lui, devient démocratique et populaire. Ainsi tout individu qui a conclu le pacte est à la fois souverain (puisqu'il participe à l'expression de la volonté) et aussi sujet (parce qu'il se soumet à cette même volonté). La monarchie disparaît ici, remplacée par la souveraineté populaire. C'est donc la volonté populaire qui décidera quel régime politique elle se donnera.
Tx.Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du droit politique, 1762 :
« Puisque aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. » (I, 4) ;
Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. » (I, 6) ;
Les clauses de ce contrat, bien entendues, se réduisent toutes à une seule - savoir, l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté: car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous [...] De plus, [...] chacun se donnant à tous ne se donne à personne. » (Ibid.) ;
Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit aux termes suivants : Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. A l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif » (Ibid.).
Frontispice de l’édition originale du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, publiée à Amsterdam en 1762. Source : collection privée.
Ces remises en cause de la tradition politique s'inscrivent dans un vaste mouvement d'idées, philosophiques notamment, qui met la raison, le progrès et la tolérance à l'honneur. Ce mouvement s'incarne notamment dans l'Ecole philosophique où de nombreux penseurs (Locke, Hume, Voltaire, Diderot et d'Alembert, d'Holbach, Rousseau, etc.) n'hésitent plus à soumettre la religion et le pouvoir royal à la critique et à proclamer, souveraine, la raison humaine. L'effet multiplicateur des Lumières s'intensifie et c'est peut-être moins la nouveauté des idées qui frappe que leur vitesse de diffusion. Le nombre de ceux qui savent lire est multiplié par quatre et l'enseignement se développe. La masse des nouveaux instruits réclame une place dans la société et nourrit la contestation au grand dam des élites, dont l'avocat général Séguier par exemple.
Tx.L'avocat général Séguier dénonce les philosophes en 1770 :
« Les philosophes se sont élevés en précepteurs du genre humain. Liberté de penser, voilà leur cri, et ce cri s'est fait entendre d'une extrémité du monde à l'autre. D'une main, ils ont tenté d'ébranler le Trône ; de l'autre, ils ont voulu renverser les Autels. Leur objet était de faire prendre un autre cours aux esprits sur les institutions civiles et religieuses, et la révolution s'est pour ainsi dire opérée... Éloquence, poésie, histoire, romans, jusqu'aux dictionnaires, tout a été infecté. A peine ces écrits sont-ils devenus publics dans la capitale, qu'ils se répandent comme un torrent dans les provinces ; la contagion a pénétré dans les ateliers et sous les chaumières » (Cité dans Félix Rocquain, L'esprit révolutionnaire avant la Révolution, Paris, 1878, p. 278.).
Dans un sens proche, les idées nouvelles pénètrent également la vie économique, ce qui contribue à ébranler les anciennes structures (hiérarchie sociale). Les physiocrates, courant de pensée qui se développe à partir des années 1750 avec pour chef de file le docteur François Quesnay (1694-1774), prônent la liberté dans la production et le commerce (« laisser faire, laisser passer »). Ce libéralisme, hostile au système corporatiste ancien et à la propriété seigneuriale, est en contradiction avec les idées de contrôle et de police économique de la monarchie.
D'autres forces contraires s'expriment également au lendemain de la mort de Louis XIV, contribuant à créer un climat délétère durant tout le XVIIIème s.. C'est par exemple la réaction aristocratique. Les privilégiés, vexés du traitement que leur a infligé le roi soleil à partir de 1661 (« gouvernement personnel »), cherchent à rétablir ce qu'ils considèrent comme les droits et les privilèges naturellement attachés à leur naissance ou à leur fonction. La réaction aristocratique se traduit par un certain nombre d'accaparements qui interdisent aux roturiers de progresser dans certains corps (l'armée, l'Église, les parlements et les cours souveraines, le Conseil du roi, les états provinciaux, etc.) Louis XV et Louis XVI lutteront avec plus ou moins de succès contre ces privilégiés, d'autant plus que la nation prend souvent leur parti.
Mais c'est peut-être l'opposition parlementaire qui constitue le phénomène le plus marquant en la matière.
Le conflit entre le roi et les parlements trouve son origine en matière religieuse (les parlements sont favorables aux jansénistes et le pouvoir royal aux jésuites), puis, rapidement, il s'étend sur le terrain fiscal (hostilité à l'égard de l'égalité fiscale). Les parlementaires vont alors instrumentaliser le droit de remontrance restauré par le régent Philippe d'Orléans (voir la déclaration royale du 15 sept. 1715, ci-dessous) et en faire un puissant outil d'obstruction politique.
Tx.Déclaration royale du 15 septembre 1715 :
« Louis etc., Salut. La fidélité, le zèle et la soumission avec lesquels notre Cour de Parlement a toujours servi le Roy notre très honoré seigneur et bisaïeul, nous engageant à lui donner des marques publiques de notre confiance, et surtout dans un temps où les avis d'une Compagnie aussi sage qu'éclairée peuvent nous être d'une si grande utilité, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus honorable pour elle et de plus avantageux pour notre service même, que de lui permettre de nous représenter ce qu'elle jugera à propos avant d'être obligée de procéder à l'enregistrement des édits et déclarations que nous adressons, et nous sommes persuadé qu'elle usera avec tant de sagesse et de circonspection de l'ancienne liberté dans laquelle nous la rétablissons, que ses avis ne tendront jamais qu'au bien de notre État, et mériteront toujours d'être confirmés par notre autorité.
A ces causes, de l'avis de notre très cher et très aimé oncle le duc d'Orléans, Régent [...] et autres grands notables personnages de notre royaume, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et déclaré [...].
Voulons et nous plaît que lorsque nous adresserons à notre Cour de Parlement des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes émanées de notre seule autorité et propre mouvement, avec nos lettres de cachet portant nos ordres pour les faire enregistrer, notredite Cour avant d'y procéder puisse nous représenter ce qu'elle jugera à propos pour le bien public de notre royaume [...]
Donné à Vincennes, le 15e jour du mois de septembre, l'an de grâce 1715 [...] ».
Face à la résistance du pouvoir royal, les magistrats n'hésitent pas à suspendre leur service, voire à présenter des démissions collectives. Pour justifier en outre leur résistance, les parlements exhument une thèse pseudo-historique forgée au XVIème s. par le chancelier Michel de L'Hospital, la théorie des classes, par laquelle ils s'instituent les héritiers des droits de la nation. Les parlementaires déclarent que les différentes cours seraient toutes issues du même tronc : les plaids généraux des rois francs et la cour des premiers Capétiens. Grâce aux effets rhétoriques de l'avocat janséniste Adrien Lepaige (1753), les parlementaires considèrent que les cours, sessions et classes sont solidaires car elles appartiennent à une institution unique et indivisible, le Grand Parlement de France. Ainsi les cours doivent soutenir et secourir celles dont les droits sont ignorés par la monarchie. Par ailleurs les parlements se déclarent aptes à vérifier librement des lois du roi. Sur le fondement de cette théorie, les parlements s'affirment les dépositaires face au pouvoir royal des droits de la nation.
Ce fond idéologique (théorie des classes) et juridique (remontrances) va recevoir une application concrète dans le cadre de l'affaire La Chalotais, qui marque l'apogée de la crise institutionnelle de l'Ancien Régime. Le procureur général au Parlement de Bretagne, Louis-René de Caradeuc de La Chalotais (1701-1785), est un farouche opposant au gouverneur de la province de Bretagne, le duc d'Aiguillon (1720-1788).
Portrait de Caradeuc de La Chalotais, Louis-René de (1701-1785) (gravure de C. Baron d’après le dessin de Charles-Nicolas Cochin, 1764). Source : BNF - domaine public.
Les états de Bretagne, soutenus par La Chalotais, refusent de voter les impôts demandés par le gouverneur au nom du roi. Le Parlement rend alors un arrêt qui interdit la levée d'impôts auxquels les états n'ont pas consentis. Le Roi annule l'arrêt, ce qui entraîne la démission de tous les membres du Parlement (octobre 1764 - mai 1765). C'est alors que Louis XV va solennellement et très vigoureusement rappeler les parlements à leur devoir, dont celui de Paris, lors de la célèbre séance royale dite de « La flagellation » (3 mars 1766). Le roi y déclare notamment que la théorie des classes est une imposture, que les magistrats ne sont que de simples agents royaux et que leurs prérogatives résultent d'une délégation du monarque.
Tx.Pour le texte du discours de la flagellation, voir Flammermont,
Remontrances du Parlement de Paris, tome II, Paris, 1895, pp. 555 sq avec texte en ligne sur
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6535528k/f612 :
"Dans son discours, Louis XV rappelle notamment que « l'ordre public tout entier émane de [lui], et les droits et les intérêts de la nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, sont nécessairement unis dans [ses] mains, et ne reposent qu'en [ses] mains".
Mais l'insoumission parlementaire persiste. Le roi fait alors enregistrer un nouvel édit prohibant toute référence à la théorie des classes et interdisant aux parlements de faire grève ou de présenter des démissions collectives : c'est le lit de justice du 7 décembre 1770.
En savoir plus : Jussions, itératives jussions, lit de justice
Traditionnellement le roi dispose de différents moyens de procédures pour contourner l'obstruction parlementaire, qui lui servent également à réaffirmer ponctuellement son autorité. La technique des lettres de jussion permet au roi, dans un premier temps, d'ordonner l'enregistrement d'un texte s'il estime que les remontrances des cours sont injustifiées. Mais les cours peuvent opposer un second refus (itératives remontrances), provoquant de nouvelles lettres de jussion. Si aucun compromis n'est trouvé, soit les cours finissent par obtempérer en mentionnant au bas de l'acte qu'elles l'enregistrent de « l'exprès commandement du roi », soit elles ne défèrent pas aux lettres de jussion réitérées et se préparent alors à l'enregistrement forcé. Il s'agit pour le roi de recourir à la procédure rare, mais édifiante, du lit de Justice, qui lui permet de siéger en séance du parlement (en personne en cas d'affaire grave) et ainsi faire enregistrer l'acte « de force ».
Après le lit de Justice du 7 décembre, le Parlement de Paris suspend à nouveau le cours de la justice. La royauté réagit en lançant un vaste train de réformes ; c'est la réaction.
Durant les dernières décennies du XVIIIème s., le roi et certains de ses ministres sont conscients du fait que le royaume doit être profondément réformé. Des mesures sont engagées les domaines judiciaire (1), économique (2), fiscal (3), mais peu aboutissent.
C'est le récent chancelier René Nicolas de Maupeou (1714-1792) qui est chargé de mener à bien la réforme judiciaire. Il était d'ailleurs intervenu dans l'affaire de Bretagne (La Chalotais) en soutenant le duc d'Aiguillon. Il avait du reste conseillé au roi d'agir avec fermeté envers les parlements, avant le lit de justice de décembre.
Portrait de Maupeou, René Nicolas Charles Augustin de (1714-1792). Lebeau. Graveur, Marilly. Dessinateur, s.d. Source : BNF - domaine public.
Face à l'impasse de l'affaire de Bretagne, Maupeou brise habilement l'esprit de corps qui anime les magistrats – il fait exiler les plus récalcitrants – et met en place une réforme judiciaire ambitieuse au début de l'année 1771. Il fait supprimer la vénalité des charges (les juges sont désormais nommés, appointés et révocables), la justice est déclarée gratuite (les épices sont interdites), l'immense ressort du Parlement de Paris est divisé en cinq conseils supérieurs de justice (Blois, Châlons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Lyon et Poitiers), des conseils supérieurs du même type remplacent également les parlements de province et, enfin, le droit d'enregistrement est maintenu pour onze parlements de province et le parlement de Paris, mais les remontrances ne sont plus publiées. De violentes protestations s'élèvent alors. Dans un souci d'apaisement le chancelier réintègre peu à peu les magistrats modérés et rembourse certaines charges supprimées. Mais il ne parvient pas à maîtriser la coalition aristocratique. Puis Louis XV meurt et Louis XVI, dépassé par les évènements, disgracie Maupeou le 24 août 1774. Le chancelier note alors avec amertume : « J'avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis trois siècles. S'il veut le perdre encore, il est bien le maître ».
Le 12 novembre de la même année le roi, en lit de justice, anéantit définitivement la réforme. On sait que ce fut une grave faute politique. Elle ne put d'ailleurs être rattrapée par la réforme menée par le garde des Sceaux Chrétien François de Lamoignon (1735-1789) et inspirée de celle de Maupeou. La réforme est enregistrée en lit de justice le 8 mai 1788, à Versailles. Mais elle ne survit pas à la révolte aristocratique qui s'insurge contre le despotisme ministériel, ni au manque de courage politique de Louis XVI qui renvoie son ministre de la justice.
En matière économique, Louis XVI fait appel à Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) et le nomme contrôleur général des finances. Turgot, ancien intendant de la généralité de Limoges, est adepte des thèses physiocrates et cherche à en appliquer les principes à l'administration et à l'économie du royaume. Reprenant les idées de Bertin et de Laverdy, il proclame la liberté de circulation des grains et de leur importation en 1774 ; le préambule de l'édit de 1774 est une critique contre l'interventionnisme et fait l'apologie de la liberté. Mais les mauvaises récoltes de l'année entraînent des difficultés et des émeutes aux abords de la capitale (guerre des farines). Turgot doit prendre des mesures sévères pour maintenir l'ordre, ce qui lui vaut l'hostilité du Parlement, d'où le demi-succès de l'édit de 1774.
Turgot, Anne-Robert-Jacques (1727-1781). Le Beau, graveur. 1774). Publication : 1774. A. P. D. R. à Paris chez Le Beau, rue S.t Jacques, maison de la veuve Duchesne, libraire au Temple du G.t. Source : BNF - domaine public.
Turgot s'attaque par ailleurs à la liberté du travail qui n'existe pas sous l'Ancien Régime, puisque prévaut un système monopolistique et corporatiste. Il est ainsi à l'origine d'un édit de janvier 1776 qui dissout les corporations, les maîtrises, les communautés professionnelles et les confréries. Il supprime également la corvée royale, il institue une subvention territoriale sans privilèges pour l'entretien du réseau routier et crée une Caisse d'escompte. Mais ses mesures sont mal accueillies et Turgot est finalement renvoyé par Louis XVI en avril 1776. Le roi fait alors rétablir la police des grains et les corporations.
Dans le domaine fiscal la situation est sérieuse. Les ressources traditionnelles ne suffisent notamment pas à combler les besoins de l'État. En 1783 Charles Alexandre Calonne (1734-1802) est alors appelé au Contrôle général des finances afin de remédier à la situation et préparer une réforme. Celle-ci doit nécessairement être ambitieuse. On envisage donc, pour y parvenir, de convoquer une assemblée de notables chargée d'approuver la réforme. L'assemblée s'ouvre à Versailles le 22 février 1787. Calonne a un double projet financier : d'une part supprimer ou améliorer les impôts anciens (abolition des douanes intérieures, uniformisation et diminution de la gabelle, suppression du vingtième, plafonnement de la taille) et, d'autre part, créer un impôt nouveau, la subvention territoriale, impôt direct destiné à fournir à la monarchie ses principales ressources (sur les impôts et les finances de l'Ancien Régime, voir leçon 8). Cet impôt doit frapper les revenus de tous les biens fonciers, y compris ceux du domaine royal, de la noblesse et du clergé. Face à cette « révolution fiscale » l'Assemblée des notables est réticente et fait échouer le projet. Surnommé « Monsieur déficit » par l'opinion publique, Calonne est renvoyé en avril 1787 (voir sa caricature ci dessous).
Caricature de Charles-Alexandre Calonne (1734-1802) en paralysé.Estampe non identifiée, vers 1790. Source : BNF - domaine public.
Étienne Charles Loménie de Brienne (1727-1794) remplace alors Calonne au contrôle général des finances (1er mai 1787) et tente de faire passer un nouvel impôt foncier général. Mais il rencontre à son tour l'opposition du Parlement. Il se retire le 25 août 1788, à la veille de la Révolution.
Sy.On sait que la consultation et le contrôle des assemblées représentatives (contre-pouvoirs) contribuent à équilibrer l'exercice du pouvoir monarchique. Aux antipodes des fantasmes d'arbitraire royal ou d'absolutisme illimité, ce mode de gouvernement nécessaire va de pair avec une certaine tradition contestataire française, qui anime la vie politique des trois siècles de l'Ancien Régime. Mais au XVIIIème s. les profondes mutations économiques et sociales rendent indispensables des réformes structurelles. Incapable néanmoins de réagir avec efficacité dans tous les secteurs clefs (économie, fiscalité, justice), la monarchie précipite son déclin.
De l'idéal au réalisme, de l'absolutisme théorique à l'équilibre du pouvoir exercé par un seul, l'esprit de l'État monarchique dévoile ses contradictions et fait échouer les préjugés, pour mettre en lumière un régime durable et somme toute cohérent, ainsi que le confirme également la pratique gouvernementale avec le jeu des institutions (cf. leçon 8).


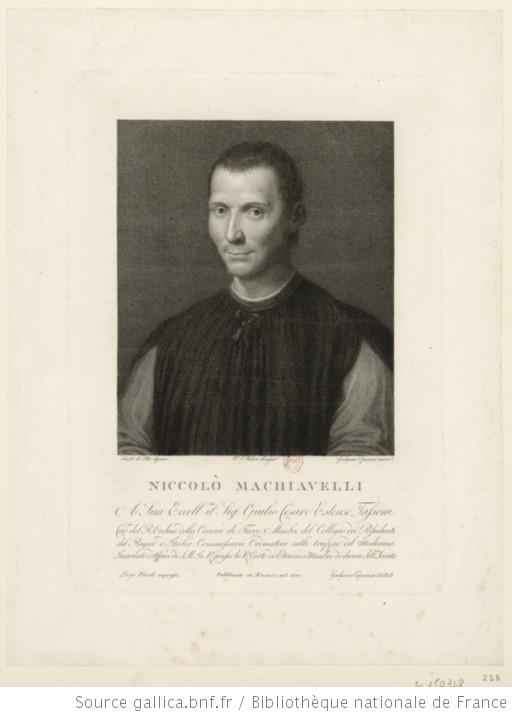
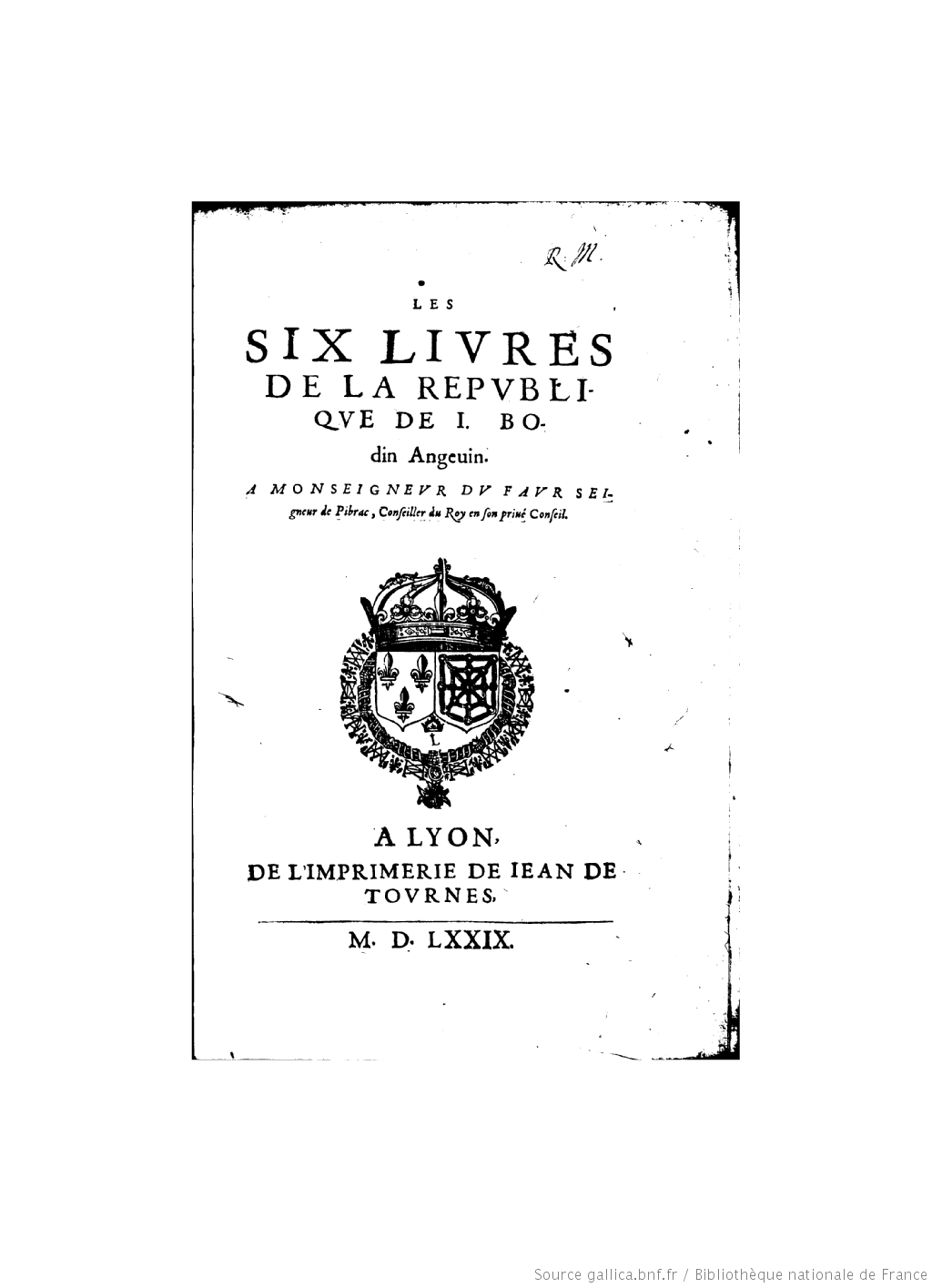


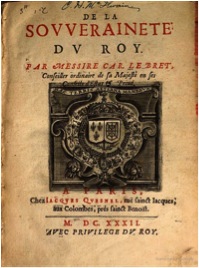









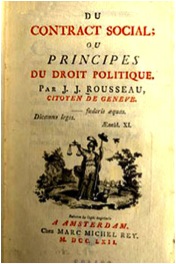




Partager : facebook twitter google + linkedin